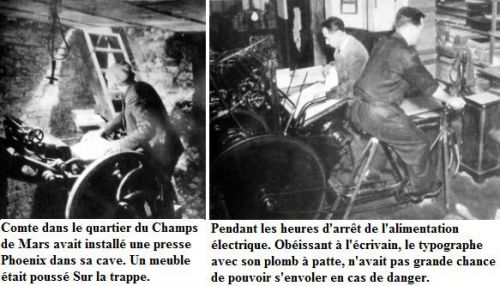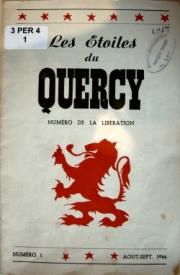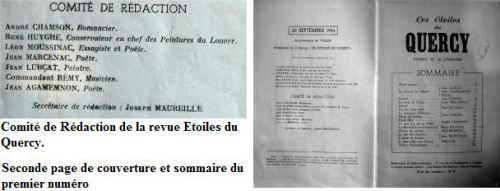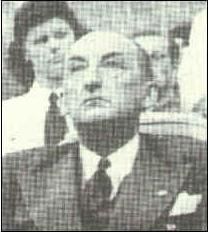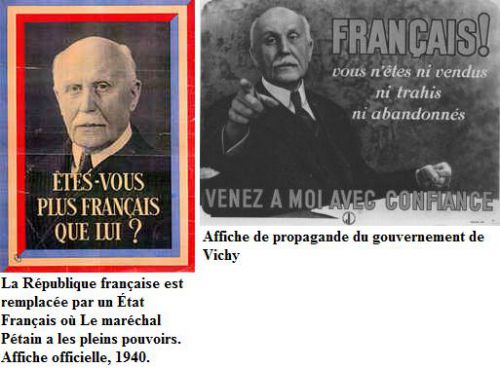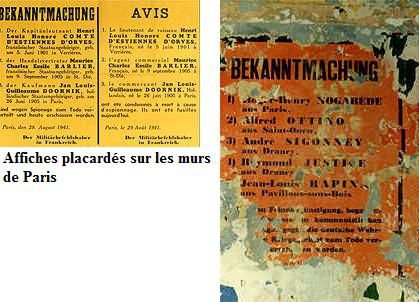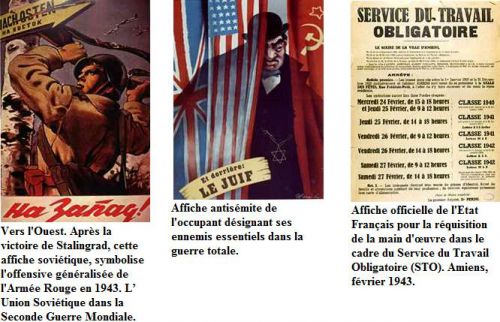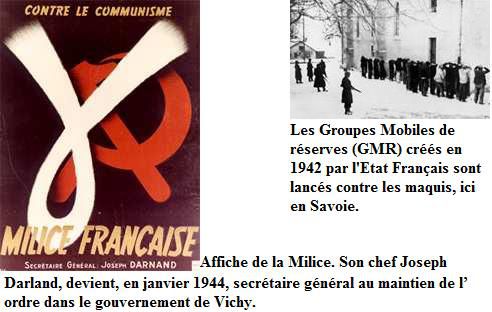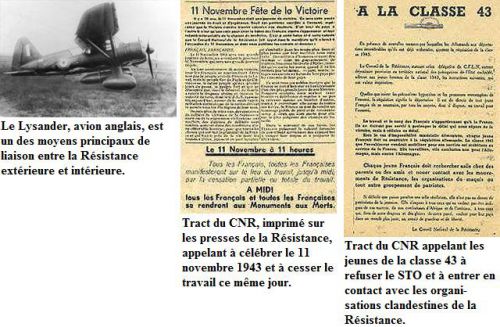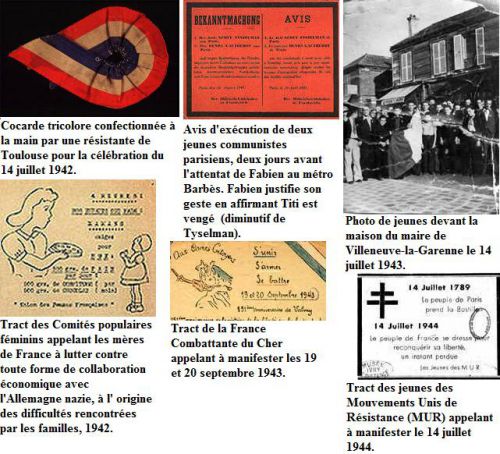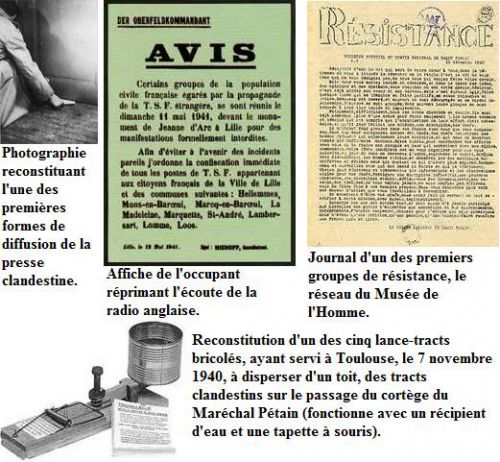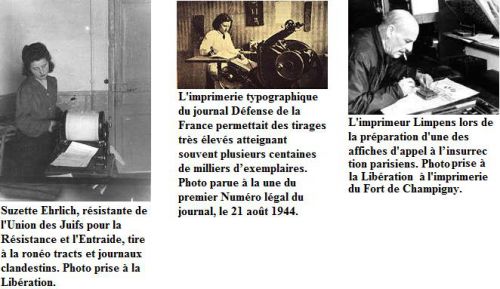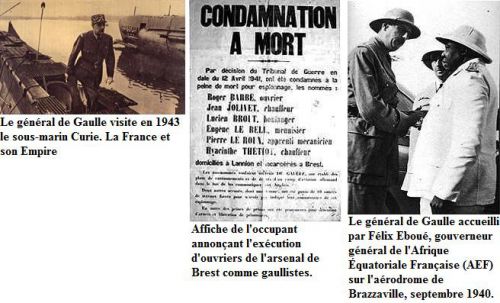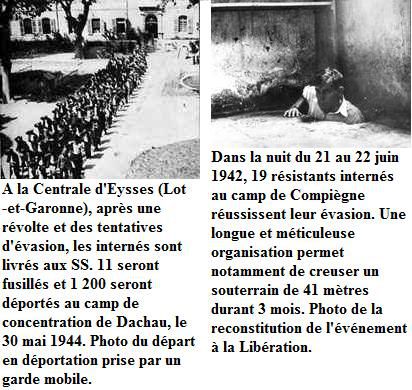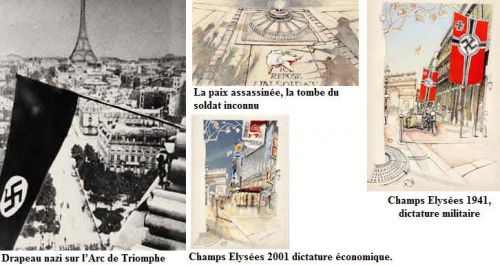HISTOIRE
L’IMPRIMERIE CLANDESTINE DES FTPF DU LOT
Dans un petit chemin forestier des environs de Latronquière un monstre ruisselant de soleil avance lentement. C’est un gros camion des FTPF chargé d’un pesant matériel d’imprimerie : massicot, pédale, moteur électrique, cases, stock de papier, boites d’encre.
Arrivé au hameau de Malbouyssou, dont les maisons se cachent au milieu des bois, il s’arrête devant une masure entourée par des ronces. On pousse une porte branlante ; le plancher aux poutres écartées, laisse entrevoir la cave, c’est pourtant là qu’il va falloir installer les machines.
Tout est bientôt en place. Dans la pénombre de la première salle le massicot et la pédale luisent. La seconde salle est occupée par les rames de papier blanc, rose, vert, jaune, bleu, orange. De grandes feuilles tricolores, format colombier, attendent les caractères gras qui annonceront bientôt les manifestations du 14 juillet, puis, plus tard, la libération du département et la libération de Paris, lorsque le peuple de la capitale aura chassé, quelques semaines plus tard, le boche pris au piège.
Avec tout ce matériel, le lieutenant Marcenac, dit Walter, avait amené Lucien, ouvrier typographe de Figeac, qui, abandonnant sa femme et ses deux enfants, venait se battre au Maquis sans mitraillette et sans grenade, mais avec ses armes : les petits caractères de plomb. Désormais, au travail !
Des journaux seront bientôt envoyés dans toutes les formations F.T.P.F. de la région du Lot. Des tracts rédigés par Roland, jeune étudiant alsacien israélite, licencié en allemand, seront lancés devant les troupes de la Wehrmacht. Michel, chef militaire du P.C. régional, en écrit pour ses camarades russes encore détenus par les officiers d’Hitler.
Bien des fois, les textes sont apportés dans la nuit ; Lucien se lève en hâte, une bougie éclaire les cases, et peu à peu, les caractères, les phrases, se forment, les articles sont composés. Alors Carmen, qui, poursuivie par la Gestapo, a été obligée de quitter son service d’agent de liaison, va les imprimer. Le moteur électrique est mis en marche, et, dans l’ombre, le bruit régulier de la pédale reprend sa complainte.
Le jour, il faut faire attention. Une colonne ennemie peut circuler sur la route voisine, le ronronnement des machines pourrait lui donner l’éveil. Qu’adviendrait-il alors des granges, du bétail et des récoltes des fermes environnantes ? Qu’adviendrait-il surtout des braves paysans : Sainte-Marie, maire de la Bastide-du-Haut-Mont, résistant de la première heure, hôte des premiers Maquis, Bousquet, ancien combattant, mutilé en 1917 sur le front de l’Aisne, qui ont recueilli les imprimeurs ? Car la guerre n’est pas terminée dans la région. Pendant la dernière semaine de juillet, l’alerte est donnée dans tous les secteurs. Les troupes nazies veulent remonter vers le Nord et le long des routes les détachements des F.F.I. se mettent en embuscade. La Gammon, grenade antichar, est légère dans la main du Franc-Tireur.
Malgré la guerre, qui, tous les jours détruit les villages, incendie des fermes, frappe des camarades au combat en plein front, le premier numéro du Partisan, édité sur les presses clandestines de l’Imprimerie F.T.P.F. de la région du Quercy, paraît à l’occasion du 14 juillet. Il apporte au Maquisard des échos de la Révolution française et des manifestations de notre fête nationale, commémorée malgré la présence des occupants, à Figeac la ville aux 800 déportés, à Gourdon en deuil où l’on pleure encore les otages assassinés par les nazis, à Bagnac et à Saint-Céré, à Payrac et à Souillac, à Martel, à Bretenoux. Le Maquisard du nord a ainsi des nouvelles du secteur sud : ses camarades des environs de Cahors ont célébré militairement ce 14 juillet d’espoir qui est encore un 14 juillet de guerre, ils ont détruit des routes autour de Cahors, ils ont attaqué le boche.
Quelques titres de la presse clandestine.
Le Front National, installé à la Source Salmière, puis dans Alvignac même, fait aussi paraître son journal clandestin La Liberté. Les troupes allemandes sont toujours à Cahors. Des convois traversent Figeac, Saint-Céré, Gourdon, Souillac, des avions à croix gammée survolent encore la campagne, mais la parole des vrais Français atteint ceux qui espèrent, ranime la confiance de ceux qui luttent, renforce encore celle des meilleurs ; le message du Général de Gaulle est diffusé aux habitants des communes libérées du Lot. On leur explique le rôle des Comités locaux de Libération, expression populaire du Gouvernement provisoire de la République ; il définit les tâches essentielles du Front National ; on leur transmet les résultats pratiques des décisions prises par le Comité départemental de la Libération au sujet du ravitaillement et des réquisitions. On leur annonce que le 20 août sera une grande journée de solidarité patriotique.
Enfin, c’est Jean Lurçat, dit Jean Bruyères, directeur de la Presse, qui traverse rapidement la route Nationale 20 où les Allemands passent toujours. Il va à Gourdon faire imprimer Les Etoiles, organe du Comité national des intellectuels, qui, plus que jamais, sont au service du peuple en armes. Ce journal, s’adresse plus spécialement aux étudiants, aux instituteurs, aux professeurs, aux artistes F.T.P.F., à tous les intellectuels résistants. J’ai vu Jean Lurçat, cahoté sur le porte-bagages d’une motocyclette ; j’ai vu le mécano, la mitraillette en bandoulière, conduire l’artiste qui portait à l’imprimerie des F.T.P.F. des œuvres d’Éluard, d’Aragon, de Moussinac, de Vercors. Le peuple français est en armes, tout le monde dans le circuit.
Le 4 octobre 1943 fut distribué le premier journal clandestin de la résistance du Lot : Le Lot résistant.
Dès que les tirages sont terminés, une voiture va chercher les exemplaires du Partisan et de La Liberté au Malbouyssou, puis les emporte au Château de l’Alzac, où est installé le P.C. régional depuis plus d’un mois. De là, l’équipe des agents de liaison motocyclistes, les Moutards, comme les appelle Michel, va les répandre au secteur A, chez Coujoux, installé à Gluges, chez Emmanuel (mort pour la France en allant libérer Toulouse), commandant le secteur B, établi à la Gineste. Des P.C. de secteur les journaux sont répartis dans les bataillons, les compagnies et les sections. Chaque Franc-Tireur aura son journal. Les Libertés sont déposées chez le Responsable du F.N., les paysans et les artisans des campagnes, les intellectuels et les ouvriers des petites villes déjà libérées ne sont pas oubliés. Tous les Français résistants reçoivent des informations exactes sur la situation et des mots d’ordre pour continuer la lutte jusqu’à la libération totale.
En effet, totalement isolés dans les bois, menant la vie des traqueurs ou des pionniers de quelque Far-West disparu, en état d’alerte perpétuelle, les chars allemands rôdant encore sur les routes, les jeunes combattants de la Liberté sont bien informés. Car ce n’est pas un torchon de Vichy qui, se glissant dans les taillis, vient leur raconter des histoires et des mensonges, c'est un journal, une petite feuille au format très réduit.
Certes, mais un journal créé pour eux, écrit par des camarades de combat, imprimé dans une chaumière délabrée qu’ils protègent. Tous les mots du Partisan, de La Liberté et des Etoiles, sont des mitraillettes, des fusils et des grenades. Tous les mots des journaux clandestins sont des armes dans la tête et dans le cœur de celui qui, chaque matin, à son réveil, chante face au soleil levant : Je suis vainqueur !
L’imprimerie de la Résistance
Il faut encore évoquer les services annexes que le temps nous permit de mettre sur pied. Ainsi se posa très tôt le problème d'une imprimerie du maquis. Nous avions longtemps travaillé grâce aux seules machines à écrire, le tirage stencil nous permettant de multiplier les instructions. Puis, un jour, la nécessité de disposer d'un journal de liaison rendit impérative l'installation d'une imprimerie à nous. Comment faire ?
Nous avions appris à prendre les choses là où elles étaient. Il fut décidé de déménager une imprimerie. On en choisit une à Figeac et je chargeai Jean Marcenac (capitaine Walter) de régler l'affaire.
L'imprimerie clandestine installée chez Monsieur Sainte-Marie, maire de Labastide du Haut-Mont.
Deux camions, une voiture légère, des gars résolus et bien équipés : Marcenac réussit sans trop de peine à monter son coup et le matériel nécessaire atterrit un beau matin dans une ferme écartée de Labastide-du-Haut-Mont, chez le maire Sainte-Marie.
Le problème n'était pas résolu pour autant : manquait encore le technicien qui ferait tourner la machine. Nous n'avions d'autre choix que de capturer l'imprimeur. Marcenac partit à nouveau en mission et ramena donc le bonhomme qui devint l'imprimeur clandestin du maquis, en quelque sorte un résistant contraint et forcé comme il y en eut pas mal. Nous fîmes courir le bruit, afin d'éviter les représailles, que le maquis avait emmené de force le malheureux.
On n'eut plus désormais qu'à fournir de la copie à ce nouveau « collaborateur » bénévole. Nous ne manquions pas de matière, entre nos informations propres et la littérature du Front national, et c'est ainsi que s'imprimèrent dans le Lot, Aragon et Jean Lurçat, Éluard et Vercors, et tant d'autres poètes de la nuit. Ainsi fut fondé le journal Le Partisan qui fut, en même temps qu'un organe de liaison, un organe de propagande. Les premiers numéros du Partisan étaient ronéotypés sur une seule face, puis ils le furent recto-verso en 21 x 27 avant d'être imprimés.
A la Libération, on ramena l'imprimerie à Figeac, puis quelque temps après on fit imprimer le journal sur les presses de Cahors.
Plus au nord, dans les forêts du Ségala, non loin de Latronquière, le lieutenant Marcenac des FTP dirige une imprimerie du maquis de juin à août 44, aidé par le peintre cartonnier d'Aubusson, Jean Lurçat. Il emploie des typographes professionnels de Figeac. Un jeune étudiant juif d'alsace traduits les tracts FTP en allemand et les dépose sur les routes fréquentées par la Wehrmacht. Pour le premier numéro de Partisan, publié le 14 juillet 1944, Lurçat apporte des œuvres d'Éluard, d'Aragon et de Vercors à composer à l'imprimerie des bois. En octobre 1944 Les Etoiles du Quercy déclare devoir son origine à cette presse du maquis et souligne le rôle local du texte imprimé dans la transmission des ordres de commandement des FTP aux maquis du Ségala : Totalement isolés dans les bois, et menant une vie de pionniers traqueurs dans une saga du Far West, les jeunes combattants de la liberté sont en permanence tenus informés par la presse.
Les Etoiles du Quercy, est une revue fondée à Cahors (7 rue de la Préfecture, puis 12 rue Wilson) par Jean Lurçat, le commandant Rémy (1) et Jean Agamemnon, et dont le premier numéro porte la date d'août-septembre 1944 et a pour titre Numéro de la Libération. Cette revue n'est pas en soi totalement nouvelle, puisqu'elle fait suite à Quercy, revue autorisée par Vichy, ayant paru entre décembre 1941 et octobre/novembre 1943, et qui saluait ouvertement le Maréchal. Son ancien rédacteur, Joseph Maureille, semble néanmoins proche du groupe formé par Jean Lurçat, puisqu'il devient secrétaire de rédaction de la nouvelle revue. Cette revue, se présente comme une tribune dans laquelle s'expriment des écrivains d'origine quercynoises ou liés au Quercy par le combat soutenu sur son sol. Les collaborateurs à la revue sont des résistants actifs, ou qui ont lutté, travaillé, effectué des missions dans le département du Lot, et qui peuvent donc aujourd'hui porter la parole de pays. Par ailleurs, la revue est placée sous le patronage d'honneur comporte les noms de martyrs de l'action résistante : Jacques Decour, Saint-Pol Roux, Georges Politzer, Max Jacob, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Jaubert, Hoogh.
Cette revue ne paraitra cependant que trois fois, avant de disparaitre en janvier 1945.
Le premier numéro se consacre à la Libération, avec des articles de Jean Cassou, Léon Moussinac, André Chamson, René Huyghe, Jean Marcenac et des contributions signées Paul Éluard ou Aragon. Le second numéro d'octobre 1944, présente entre-autres, un portrait d'Antoine de Saint-Exupéry par René Kerdyk, une étude de Jean Lurçat sur les intellectuels dans le Quercy, un témoignage de Pierre Mazars sur Cahors libéré, un article de Noël Baillif sur l'imprimerie clandestine des FTPF du Lot (Article reproduit ci-dessus). Le troisième et dernier numéro, paru début 45, présente une lettre inédite de Marcel Proust, des contributions dont certaines déjà publiées dans la clandestinité, de Charles Vitrac, Paul Éluard, Jean Paulhan, Jean Lurçat, Maurice Fombeure, Jean Marcenac, Tristan Tzara, Léon Moussinac, Luc d'Estang, Pierre Mazars, etc.
JEAN LURCAT RÉSISTANT LOTOIS
Jean Lurçat,
Simone Lurçat (née Selves), épouse de Jean Lurçat, a raconté le travail et l’œuvre de celui dont elle partagea la vie à partir de 1944. Son ambition pour l’art de la tapisserie, son rapport aux autres, son goût du travail collectif. Elle évoque sa rencontre avec lui, dans le Lot, au cœur du maquis et les années heureuses passées à Saint-Céré où Jean Lurçat avait construit un atelier à sa dimension, dans sa propriété des Tours Saint-Laurent.
En août 1941, Jean Lurçat quitte Aubusson et, après un très bref séjour à Collioure, se réfugie dans le Lot où il s'installe à Lanzac en 1942. Rapidement associé au combat de la résistance, son engagement l'amène à changer fréquemment de lieux de résidence : le Château de Grézols à Saint-Cirq Lapopie, Lanzac, Souillac. En 1944, il est nommé membre du comité de Libération du Lot et est chargé du travail d'organisation dans le secteur Souillac Alvignac Saint-Céré Figeac. Il dirige le journal Liberté et la revue Les Etoiles du Quercy. C'est au cours des opérations clandestines qu'il rencontre sa future épouse, Simone, et découvre les Tours de Saint-Laurent. En septembre, après avoir participé à la libération de Cahors, il devient directeur des Services culturels du département.
La presse clandestine
Presse officielle national-socialiste dans la région du Rhin-Supérieur : propagande parue en dernière page de l’Oberrheinischer Heimatkalender 1943.
Pendant la nuit de l'oppression, la presse clandestine. Allocution de M. Pierre Schmitt, Conservateur de la Bibliothèque.
A l'occasion de l'ouverture de l'exposition La Presse clandestine le 1er décembre 1945, au Foyer du Théâtre Municipal de Colmar, M. Pierre Schmitt, Conservateur de la Bibliothèque, a prononcé une très belle allocution dont voici quelques passages exaltant l'œuvre magnifique de la presse clandestine en France pendant l'occupation.
Est-il besoin de vous rappeler ici l'époque terrible où la France, désarmée, impuissante, brimée par l'ennemi et les valets à sa solde devait assister à l'emprise toujours plus grande de l'occupant ? Mais, sûr de sa puissance, une fois encore celui-ci a manqué de sens psychologique et bientôt les Français qui avaient non pas frôlé l'abîme, mais qui y avaient été littéralement précipités sous le formidable coup de boutoir des masses germaniques, se ressaisirent, se mirent debout, et s'armèrent, les uns de mitraillettes qui leur venaient du ciel, les autres de la plume, arme non moins redoutable dans une guerre moderne. Aujourd'hui, les uns comme les autres pleurent d'innombrables camarades, morts dans l'anonymat du combat clandestin.
On se penchera donc avec émotion sur ces journaux d'apparence modeste, sur ces tracts, sur ces minuscules papillons, imprimés dans quelque cave obscure avec des moyens de fortune, et involontairement nos pensées vont vers ces admirables ouvriers typographes qui, privés de toutes ressources matérielles et tout simplement munis d'une presse à bras, ont trouvé le moyen de faire sortir une véritable avalanche d'imprimés clandestins. On ne trouvera pas moins étonnants ces pauvres feuillets hectographies, ou tirés à la ronéo, ces journaux tapés à la machine, ou encore ce splendide album, exemplaires numérotés et tirés sur papier de luxe, qu'éditèrent les peintres français, quelque part en France, au 48e mois de l'occupation allemande.
Quelle vitalité, quelle force, quelle révolte aussi dans tous ces papiers ! Et puis, n'est-t-il pas émouvant de constater la persévérance, l'acharnement, la farouche énergie de ces lutteurs, comme aussi la haute portée morale de leurs écrits ? La souriante malice de chez-nous ne perd pas ses droits et les flèches acérées décochées à l'adresse de l'envahisseur sont innombrables. Il faut lire ces journaux ; il faut lire ces tracts, il faut lire ces feuillets uniques de papier fragile et de nuance changeante, où s'affirme tant de courage et tant de patriotisme.
Pour l'Alsace, les émotions que nous avait apportées la presse clandestine pourraient être d'une poignante nouveauté. Mais l'Alsace, elle, n'a-t-elle pas tenté d'exprimer les sentiments qui bouillonnaient en elle et l'oppressaient si douloureusement ? L'Alsace est-elle restée à l'écart ?
Non, notre Alsace, malgré son isolement tragique, a élevé sa voix. De Strasbourg nous est venu le "Manifeste des six fusillés" et le Journal libre avec ses violentes attaques contre les maîtres de brun vêtus ; du Haut-Rhin, les tracts de Charles Murbach et de ses camarades ; de Toulouse le beau fascicule du Témoignage Chrétien réservé aux Terres françaises que sont l'Alsace et la Lorraine; de Londres, d'Alger, d'Oran, des pages poignantes qui sont autant de protestations contre l'annexion arbitraire de nos provinces. Tous ces écrits, d'éloquente manière attestent la présence de nos compatriotes partout là où l'on se battait.
Partout là où l'on se battait ! Et c'est pour cela que nous n'avons pas voulu terminer cette exposition sans y avoir fait figurer ceux de nos compatriotes qui s'étaient armés à la fois du fusil et de la plume pour combattre l'éternel envahisseur, j'ai parlé de la Brigade Alsace-Lorraine dont les vertus morales et guerrières ont si magnifiquement éclaté durant toute la guerre de la libération.
Les journaux et les tracts que vous verrez sont tachés de sang. Des aviateurs qui les ont lancés sont morts en service commandé. Des intellectuels, des journalistes, des propagateurs sont morts au poteau d'exécution. Pourchassés par la police, traquée par la Gestapo, leur rang accuse de nombreux martyrs. Et ce n'est pas sans un serrement de cœur que je puis songer à ce médecin bourguignon assassiné par les Allemands pour avoir été le propagandiste acharné du cahier Alsace et Lorraine, terres françaises !, ou à cet humble typographe, lui aussi fusillé dans l'aube pâle d'une matinée parisienne et dont la veuve éplorée disait à ses enfants : Pour que la France vive, il faut des héros ; soyons fiers que le Bon Dieu ait choisi notre papa.
Paroles d'une grandeur sublime ! Un pays qui appelle sienne de telles femmes, et sienne une telle jeunesse, ne peut pas mourir ; il est prédestiné pour le combat de l'amour que seul pourra nous rendre un monde vraiment plus fraternel.
L’IMPRIMERIE DE LA RÉSISTANCE
Tous les textes traitant des imprimeries clandestines ont donné la priorité aux auteurs des textes, l'imprimeur, lui, n'apparaît que très modestement. Obéissant à l'écrivain, le typographe avec son plomb à patte, n'avait pas grande chance de pouvoir s'envoler en cas de danger.
Je me souviens de Roger Lescaret dont l'atelier était situé derrière l'Institut. Arrêté après perquisitions, incarcéré quatre mois à la Santé, ensuite pendant dix mois au camp de Rouillé. Dès sa libération, il recommence à imprimer pour l'organisation militaire clandestine.
Et Comte dans le quartier du Champs de Mars qui avait installé une Phoenix dans sa cave. Un meuble était poussé sur la trappe, lui travaillait pour Témoignage chrétien.
Et encore Harambat, avec sa barbiche de vieil artisan. C'était l'image de l'innocence. Un innocent qui imprimait tranquillement pour le MLN.
Vercors, pseudonyme du graveur Jean Bruller. Contacté par Pierre de Lescure dès le début de l'Occupation, il écrivit Le Silence de la mer pour la revue La Pensée libre fondée par Jacques Decour et Georges Politzer.
Claude Oudeville, imprimeur, composa Le Silence de la mer à la main. Tirage : trois cent cinquante exemplaires.
Yvonne Desvignes, à son domicile près du Trocadéro, plia et cousu les trois cent cinquante exemplaires du Silence de la mer, tandis que Vercors en personne les colla.
Monsieur Philippe a été pour moi la lampe de poche de l'ouvreuse me guidant dans le cinéma d'épouvante de l'Occupation. Le premier jour il m'avait fait un peu peur. Bien sûr, j'avais bricolé quelques papiers pour des amis dans la difficulté, mais il me déboulait dessus, bien renseigné, et me demanda de jouer avec lui de façon moins artisanale. A la Libération, comme d'autres quittant leurs noms de station de métro, il est devenu Enrico Pontremoli. On le voit ici avec Olga, sa femme, et Philippeau confectionnant quelques papillons lithographiques destinés à être collés sur l'Affiche rouge.
Imprimerie Défense de la France
LA PRESSE CLANDESTINE
Les imprimeurs et distributeurs de la presse clandestine ont payé un très lourd tribut à leur mission d’information d’une population soumise en permanence à la propagande vichyste et pro-allemande.
Il est essentiel, à l’époque, que la presse clandestine atteste, par sa présence, des milliers d’initiatives des réseaux et des mouvements qui couvrent le pays, et qu’elle soutienne le moral et les espoirs des Français.
Ses difficultés sont pourtant considérables. Il faut trouver, détourner le papier, matière contingentée, rare et surveillée. Il faut disposer de ronéos, d’imprimeries typographiques utilisant des plombs composés sur le marbre des journaux légaux. Des mouvements parviennent même à trouver des heures de quelques linotypes lourdes.
La distribution, aussi hasardeuse que la fabrication, se fait par les canaux les plus divers : trains, avec la complicité des cheminots, vélos puis dépôts dans les boîtes aux lettres, sous les portes, ou jets à la volée de multiples exemplaires.
Hormis un creux de la fin 1941 à la fin 1942, dû surtout à l’efficacité de la répression, le nombre des publications ne cesse de croître, pour dépasser la centaine mi-1943.
Appartement parisien transformé par Michel Bernstein en atelier de faux-papiers
Parmi les titres les plus distribués, citons : en zone sud, Combat, Libération et Franc Tireur, créés dès 1941, qui atteignent respectivement 300 000 (pour le premier) et 150 000 (pour les deux autres) exemplaires.
En zone nord, Défense de la France, qui tire courant janvier 1944 jusqu’à 400 000 exemplaires, dans les deux zones, les nombreuses publications du P.C.F. : journaux nationaux, régionaux et locaux ; diverses revues et brochures. Le tout représente en moyenne la moitié de l’ensemble des publications.
Imprimerie Défense de la France
Au total, la presse clandestine qui se développe dans les deux zones joue un rôle essentiel dans la Résistance (les Allemands ont même recours à de faux numéros afin de déconsidérer la Résistance !). À ce titre un hommage doit être rendu au souvenir d’André BOLLIER (X1938), surpris dans son imprimerie à Lyon et assassiné par la Milice en juin 1944.
LA VIE QUOTIDIENNE
Je vous pose la question : celui qui, une nuit, a ouvert sa porte au cycliste traqué, ou cette employée de mairie, providence des évadés, ou encore ce jeune couple abritant pendant une année la jeune Juive échappée à la rafle, et tant d'autres, des milliers et des milliers de ces bricoleurs de l'héroïsme ont-ils droit à l'appellation contrôlée de résistants ?
Les petites gens habitués à la vie d'atelier où tout naturellement un coup de main ne se refuse pas, n'avaient que la ruse à opposer à une force colossale. La belle affaire ! Au hasard des circonstances certains se sont trouvés embarqués dans de grandes épopées, mais restons dans le mode mineur où, remuant les souvenirs, je retrouve pêle-mêle un chauffeur des PTT, un typographe, un peintre, et un concierge.
Celui-là, chaque fois que je passe devant la porte de sa loge fermée définitivement, me revient le souvenir de son installation. Vous n'éviterez pas ma petite histoire. Je vous la raconte rapidement pour ne pas vous faire perdre du temps. Vous allez voir, c'est simple comme le théâtre de Guignol.
Donc à l'aube d'un beau matin, si l'on peut dire, de 1942, le voici prenant possession du local minuscule et immédiatement se mettant en mesure d'en faire un espace fonctionnel comme une cabine de bateau. C'est qu'il lui fallait caser la cage à serins et une quantité de tiroirs pleins de tire-bouchons, d'épluche-légumes et de toutes sortes d'accessoires ménagers.
Commence alors un bricolage intensif et sonore. Les choses, parfois réglées de façon supérieure, font alors qu'apparaissent deux tractions noires à roues jaunes qui s'arrêtent devant l'immeuble. En descendent des imperméables gris-vert, des chapeaux de feutre et un nombre équivalent de sales gueules. Pour un début, c'était tout de suite le grand bain. Arrêtons-nous un moment. Il en fallait davantage pour troubler notre concierge tout neuf.
La vie l'avait habitué aux torgnoles. De la guerre de 1914-1918, il disait : (En effet, un beau KO) qui l'avait laissé sanguinolent dans la gadoue. Un vrai chiendent, il en revient. Reprend son métier de relieur-doreur, un as, un peu plus tard, 1936, élu par acclamation délégué d'atelier.
L'ordre revient donc, viré comme un malpropre - liste noire-on vous écrira-le temps d'apprendre à vivre-se retrouve emballeur - utilisation des compétences-et vient l'étape où nous le retrouvons avec son marteau. Revenons à nos chiens. Beaucoup d'appartements étaient abandonnés. De tout foutre en l'air, même pour des spécialistes, cela prend du temps. A midi, la tornade verte redescend.
L’entrée de l'hôtel Meurice occupé par les officiers allemands étaient placées deux sentinelles en armes. Quand un officier entrait ou sortait, l'un des deux robots -impossible de déceler lequel-, émettait un bruit comme une fuite d'air comprimé.
Alors les deux mécaniques se déclenchaient en une gesticulation raide qui probablement représentait les signes extérieurs de respect. Les cyclistes passant devant l'hôtel étaient tenus de mettre pied à terre. Les distraits ou les indisciplinés, rappelés à l'ordre par nos gardiens de la paix, suivant les instructions de la Wehrmacht, devaient se soumettre à une vérification d'identité.
Après le bombardement de la Chapelle, les habitants du quartier venaient chercher refuge dans les plus profondes stations de métro. Pendant quelques jours la station Lamarck-Caulaincourt a été considérée comme l'abri idéal. Dehors, les chefs d'îlots ne badinaient pas.
Dès les premiers hurlements de la sirène, tout passant était vigoureusement invité à disparaître dans les sous-sols. C'est ainsi que mon copain et la jeune fille dont il venait de faire la connaissance chez des amis communs ont été confiés à la bonne garde de messieurs Lamarck et du général Caulaincourt.
Ce soir-là, l'alerte n'en finissait pas, heureusement qu'à côté d'eux, assis sur la même marche d'escalier, un vieux Montmartrois rigolard leur a raconté ses souvenirs du Lapin Agile. Fin d'alerte. La situation devenait délicate, cette exhumation coïncidait avec l'heure du couvre-feu, donc interdiction de circuler.
Le vieux les a pris sous sa protection. Il n'allait tout de même pas laisser cette belle jeunesse dehors. D'ailleurs, il demeurait à deux pas. Comme la chose la plus naturelle du monde, il leur a donné la meilleure chambre et de façon si généreuse, si engageante, que nos deux jeunes n'ont rien osé dire. Par timidité les voici dans de beaux draps, et là tout naturellement comme il est dit dans la Bible, ils se sont connus. A l'aube, désarroi de la petite, et nobles promesses du garçon. En effet, ils se sont mariés. Hélas ! Leurs caractères ne s'accordaient pas ! Ils furent très malheureux et n'eurent pas d'enfants.
LA LIBÉRATION DE PARIS
Porteurs de paniers à bouteilles, des jeunes gens sortaient du Collège de France. La grille était ouverte, décidément ce jour-là était exceptionnel. Il suffisait de traverser la cour puis de prendre un couloir et on se trouvait dans un laboratoire de chimie au milieu duquel un professeur et quelques élèves remplissaient des bouteilles. Les opérations s'effectuaient avec un bel entrain. C'était la première fois où je voyais régner dans un labo de chimie un climat qui rappelait la préparation de fête des Beaux-arts.
Donc après un remplissage, les bouteilles soigneusement bouchées étaient roulées dans un papier d'emballage préalablement enduit de colle et saupoudré de granulés blancs. Avec une grande amabilité le professeur a tenu à me montrer l'excellence de ses mélanges.
Au centre d'essais, une arrière-cour jonchée de débris de verre, sur un mur affecté à cet usage, le professeur a lancé une bouteille emmaillotée: explosion étouffée, nuage de fumée grise et ruisseaux de feu. La clientèle pouvait ainsi juger du bon fonctionnement du produit.
Avec deux copains de rencontre chargés de casiers à bière garnis desdites bouteilles, nous avons descendu la rue Saint-Jacques jusqu'à l'hôtel Notre-Dame. Au deuxième étage, une fenêtre ouverte sur le quai Saint-Michel était un poste idéal pour le jeu de massacre.
Ce même hôtel Notre-Dame, Blaise Cendrars en avait parlé dans un de ses bouquins, pour évoquer des rencontres amoureuses. A part quelques fausses alertes, le temps pendant lequel j'y suis resté ne m'a rien laissé de comparable.
Un F.F.I. en barricade à Saint Germain août 1944. Ensuite je ne sais plus s'il s'agit d'un souvenir réel ou la trace d'un mauvais rêve. Je ne le situe pas au pied de cet hôtel mais plutôt vers le quai des Grands-Augustins.
Je veux la chasser de ma mémoire mais elle revient toujours, cette vision de la voiture brûlée avec à l'intérieur quatre fantômes carbonisés, tordus, terrifiants. Pour rien au monde je n'aurais pris cette photo, d'autres peut-être ont pu le faire.
Est-ce une divagation fiévreuse, comment savoir ?
Ceux qui découvrent aujourd'hui les images de la libération de Paris peuvent émettre quelques doutes sur l'importance stratégique que pouvait avoir la barricade de la rue des Panoyaux.
Plutôt que de pratiquer une ironie facile, il vaut mieux chercher à comprendre comment les Parisiens avaient été amenés à prendre l'initiative de s'offrir enfin quelques jours de fête. Construire une barricade c'était accomplir ensemble les gestes qui allaient exorciser les mauvais jours.
Il y avait dans l'air une explosive envie d'être heureux qui rendait bien jolies toutes les femmes faisant la chaîne pour apporter aux castors de l'insurrection les gros pavés cubiques. Avec le sac de sable estampillé DP, défense passive, le pavé reste le matériau de base, bien sûr les épluchures de bitume peuvent servir à masquer quelques intervalles.
Mais on peut leur préférer le tonneau rempli de terre qui quoique traditionnel apporte une solidité qui a fait ses preuves en d'autres temps. D'autres forteresses étaient résolument métalliques, avec camions renversés offrant la protection de leurs blindages devant lesquels le gracieux feston des grilles d'arbres alignés apportait un élément décoratif.
L'armement des combattants était aussi composite que leurs citadelles. De quelles cachettes étaient sorties toutes ces pétoires? Comment étaient arrivés là ces fusils allemands, ces grenades à manche, ces mitraillettes Sten ? Mystère.
Et même si le guerrier n'avait au poing qu'un modeste 6,35, la bande de mitrailleuse portée en baudrier le désignait invulnérable. Tout en pédalant, pédalant, de Saint-Michel à Belleville et de Ménilmontant aux Batignolles, j'ai pu constater que comme les champignons les barricades poussent toujours dans les mêmes endroits. Curieusement, le terrain de Passy ou de la plaine Monceau ne paraît pas leur convenir.
Dans ces quartiers le sol doit être complètement dépourvu de ces spores nécessaires aux éclosions spontanées. La nouvelle avait été transmise par téléphone au PC de presse improvisé dans un appartement de la rue de Richelieu. Tout en pédalant, j'imaginais le spectacle.
Un chapelet de wagons disloqués, une locomotive fumante couchée sur le côté. J'accélérais l'allure, même dans les côtes. Le rendez-vous avait été fixé dans un bistrot devenu PC du côté de la rue Sainte-Marthe il me semble. Je me souviens très bien de l'effervescence. Un des chefs m'a confié à deux volontaires qui n'étaient pas chefs. Nous avons grimpé la rue des Couronnes, glissade vers la gare de Ménilmontant. Déception, adieu la belle catastrophe ferroviaire.
Le déraillement se situait à plus de cent mètres de l'ouverture du tunnel menant aux Buttes-Chaumont. Arrivés sur place, c'était le noir bon teint, au toucher on pouvait constater que le train marchait à côté de ses rails, voilà tout.
Retour à la lumière et roue libre rue des Couronnes, vers le métro Belleville nous avons retrouvé quelques FFI baladeurs, suffisamment nombreux pour faire un groupe genre photo de noces ! Je n'y croyais pas trop à cette photo. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, avec le temps elle me plaît bien.
TRACTS DE LA RÉSISTANCE
1943, la Résistance atteint sa majorité
15 panneaux
LA COMPLICITE DES COLLABORATEURS
Lorsqu’au contrôle du Danemark, l’Allemagne ajoute, en avril 1940, l’occupation de la Norvège, un ancien ministre norvégien de la défense et sympathisant nazi, Vidkun Quisling (ci-contre), prend la tête d’un gouvernement de collaboration. Son nom deviendra un symbole, puis une insulte : Quisling !
Vidkun Quisling
En Yougoslavie, la grande Croatie, en théorie indépendante, est dirigée par les Oustachi dont le chef, Ante Pavelitch, instaure un régime de terreur, surtout envers les Juifs et les Serbes.
La France a, dans l’Europe de l’Ordre Nouveau une place à part. Le 24 octobre 1940, Pétain, persuadé de la victoire de l’Allemagne, rencontre Hitler à Montoire (ci-contre) et engage la France dans la voie de la collaboration avec l’Allemagne.
Entrevue de Montoire le 24 octobre 1940, entre Hitler et Pétain, à l’arrière von Ribbentrop ministre du Reich
Le maréchal fait arrêter Laval, le 13 décembre 1940, mais le retour de ce dernier (qui n’hésite pas à proclamer : (Je souhaite la victoire des Allemands) est imposé par les nazis au printemps 1942. La France, dès le début, s’engage dans une collaboration politique, économique, militaire et policière.
Les ultras de la collaboration (Jean Bichelonne, Fernand de Brinon (ci-dessous), Joseph Darnand, Louis Darquier de Pellepoix, Marcel Déat, Jacques Doriot, Philippe Henriot, Jean-Hérold Paquis, René Bousquet, Paul Touvier, pour ne citer que les principaux) sont nombreux.
Fernand de Binon
Cette collaboration va être d’autant plus efficace dans le domaine de la répression que les ennemis désignés par l’un et par l’autre sont essentiellement les mêmes, dès 1940.
Grâce aux moyens répressifs mis en place (notamment l’internement par mesure administrative, c’est-à-dire par décision du préfet et non après jugement), l’Etat français va pouvoir envoyer dans les camps d’internement, créés à cet effet, tous ceux qu’il entend mettre à l’écart de la société française.
Ainsi, à l’été 1940, retrouve-t-on, dans les camps français de la région des Pyrénées (Gurs, Argelès, Le Vernet, Noé), surtout des réfugiés politiques, à savoir des républicains espagnols (envoyés en plusieurs vagues à Mauthausen : 6784 sur 9067 y sont morts), des combattants, notamment allemands et autrichiens, des Brigades Internationales, livrés par Pétain, des communistes (dont le parti a été interdit le 26 septembre 1939).
Par la suite, l’Etat français durcit la législation déjà existante, en aggrave l’arbitraire et élargit le cercle des victimes à tous les opposants (communistes, gaullistes, résistants de tous bords) et aux Juifs (en octobre 1940, les Juifs étrangers, puis, à partir d’août 1941, l’ensemble des Juifs).
Ainsi, sans qu’aucune pression allemande ne soit nécessaire, les autorités françaises rassemblent dans les prisons ou dans les camps ceux dont l’occupant va entreprendre la destruction.
C’est le gouvernement de Vichy qui crée en août 1941 et administre, sous la haute autorité des SS, le camp de Drancy, véritable antichambre d’Auschwitz, d’où partent 67 des 79 convois de Juifs déportés. C’est de l’autre plaque tournante qu’est Compiègne que le coup d’envoi est donné avec le convoi du 27 mars 1942 (1.112 personnes déportées dont seulement 19 survivent en 1945).
Ralf du Vel’ d’Hiv’ 16 juillet 1942
De même, ce sont surtout les policiers français qui arrêtent les résistants ou qui opèrent la plupart des rafles, notamment celle du Vel’ d’Hiv’ qui, le 16 juillet 1942, voit l’arrestation à Paris et en région parisienne de près de 13.000 Juifs (hommes, femmes, enfants). Comme on le voit, l’Etat français est donc une courroie essentielle dans le mécanisme du génocide.
La déportation des Juifs dont Serge Klarsfeld a recensé, pour la période du 27 mars au 11 novembre 1942, 45 convois emmenant 41.951 personnes (notamment 4.000 enfants) s’accélèrent. A la Libération, seulement 691 hommes et 21 femmes ont survécu, mais pas un seul enfant.
La résistance, elle aussi, est concernée par la déportation qui représente un des multiples moyens utilisés par l’Etat français qui a mis en vigueur le système des otages, pour liquider les résistants jugés particulièrement dangereux.
Ainsi, les premiers convois partis de France sont des convois de représailles, constitués essentiellement de résistants comme celui qui, ci-contre, quitte le camp de Compiègne et, à partir de l’été 1941, commence l’envoi de convois importants de résistants. Ce fut le cas, notamment, du convoi des 45.000 (appelés ainsi en raison de leurs numéros de matricule).
Ce convoi des 45.000 expédie à Auschwitz, le 6 juillet 1942,1.170 hommes (essentiellement communistes et syndicalistes) dont il ne reste, à la libération, que 122 rescapés.
Dénonciation
Henri Chamberlin qui portait le surnom de Lafont
Deux auxiliaires de la Gestapo ont laissé le plus sinistre souvenir : Bonny et Lafont. Henri Chamberlin, dit Lafont ( à droite ), né en 1902, plusieurs fois condamné pour vol et abus de confiance, interdit de séjour, réussit le tour de force de monter sous un faux nom un commerce prospère et de devenir un mécène de la police, gérant du mess d'une amicale de la Préfecture de Police. Son identité est découverte en avril 1940. Écroué, libéré par la défaite, il se met au service des Allemands. Peu à peu, installé rue Lauriston, il se rend indispensable à Otto, à la Gestapo, à nombre de personnages français et allemands.
D'abord indicateur, puis chef d'équipe pour le compte de la Gestapo, il monte un groupe d'individus, en majorité criminels, escrocs, souteneurs qu'il a fait libérer de prison et s'associe en mai 1941 avec l'ex-inspecteur de police Bonny, celui que le ministre Cheron avait jadis appelé le meilleur policier de France.
L'équipe Bonny-Lafont vit graviter autour d'elle un monde étonnant de dévoyés, de désaxés, de prostituées de haut vol. Elle pratiqua le marché noir à grande échelle, le trafic d'or et de bijoux volés ou empruntés de force aux juifs. Elle procéda à de vastes pillages. Elle mena grande vie, dépensant sans compter ; elle eut autour de soi une véritable cour.
Travaillant en liaison étroite avec la Gestapo, Bonny et Lafont firent des locaux de la rue Lauriston et de la place des États-Unis de terribles lieux de souffrance. C'est Bonny qui orienta la bande vers la chasse aux résistants et aux maquisards. Ils démantelèrent le réseau Défense de la France dont faisait partie Geneviève de Gaulle, nièce du général, qu'ils arrêtèrent.
L'équipe commit des meurtres crapuleux, pratiqua le chantage aux personnes traquées, fit défiler dans ses chambres de torture des dizaines de patriotes, s'occupa de lever des mercenaires pour combattre le maquis (ainsi, la légion nord-africaine).
Grâce à la tactique qui consiste à « mouiller » les gens, à des générosités intéressées, à leur fortune, au bagout de Lafont et à la sympathie qu'il pouvait inspirer, les deux compères surent avoir des relations partout et même avec de hautes personnalités. Beaucoup, parmi elles, les fréquentaient pour en obtenir non pas forcément des faveurs alimentaires, mais des libérations d'amis. Car les truands interrompaient pillages, tortures, meurtres, pour, de temps à autre, sauver quelque inculpé, rendre des services, ce qui en fait leur assurait des tolérances ou des soutiens.
Le recrutement dans la Milice en temps d’occupation allemande
Premières exécutions
Les victimes des auxiliaires français de la Gestapo ouvrent la longue liste des tués par règlements de comptes. La police allemande confie, en effet, au M.N.A.T. (Mouvement National Anti-terroriste) les exécutions auxquelles elle répugne. Enlevés de nuit, les malheureux sont emmenés en voiture et tués d'une balle dans la nuque le long d'une route. Le lendemain, un promeneur matinal découvre un cadavre avec un écriteau sur sa poitrine : Terreur contre terreur. Ainsi sont assassinés, à Lyon, le président de la Ligue des droits de l'homme, Victor Basch, et son épouse. Le même scénario se répète, à quelques variantes près, dix fois, vingt fois, des centaines de fois.
La Gestapo eût-elle été aussi efficace sans le concours des agents français (indicateurs, tortionnaires, anciens maquisards retournés) qu'elle employait ? Un rapport chiffré permet de donner une réponse, hélas, sans ambiguïté.
A Saint Etienne où la police allemande s'installe en janvier 1943, comme dans tous les autres chefs-lieux de départements, ses services comptent quinze nazis et trois cents Français à la solde de la redoutable organisation. A Paris, l'importance des affaires à traiter amène la Gestapo à déléguer ses tâches à d'abominables officines telles que celle de la bande Bonny-Lafont; rue Lauriston, et celle de Masuy, l'inventeur du supplice de la baignoire, opérant avenue Henri-Martin.
A ces premières exécutions de patriotes, font écho celles de miliciens. Leur uniforme bleu orné du gamma d'argent ou d'or, les slogans des radios de Londres et d'Alger : Miliciens, futurs fusillés, les désignent d'autant plus aux coups des résistants qu'ils ont à peine de quoi se défendre. Méfiants à leur égard, les Allemands refusent en effet de les doter d'un armement régulier.
Avec le développement de la Résistance et l'imminence d'un débarquement en France, la Milice se voit renforcée. Début 1944, Joseph Darnand, secrétaire général au Maintien de l'ordre, proclame : La Milice française a supporté pendant cinq mois les coups des assassins sans riposter. La terreur s'est accrue. Nous nous sommes organisés pour la lutte, nous avons étendu notre réseau de renseignements, nous nous sommes armés. Nous poursuivrons sans faiblesse nos justes représailles. Que nos adversaires sachent qu'aucun de leurs crimes ne restera impuni, que nous frapperons les assassins et leurs complices.
Une loi, parue au Journal officiel du 20 janvier 1944, donne effectivement à Darnand autorité pour créer des cours martiales habilitées à juger les individus agissant isolément ou en groupes, arrêtés en flagrant délit d'assassinat ou de meurtre commis au moyen d'armes ou d'explosifs pour favoriser une action terroriste .
Trois membres, non magistrats, composent la cour martiale. Dans les villes où ils opèrent, on les voit descendre d'un train, au petit matin; ils prennent aussitôt le chemin de la prison où, juges anonymes, ils prononcent une sentence, la mort en général, immédiatement exécutoire. Cette parodie de justice s'exerce, la plupart du temps, à l'encontre d'une personne désignée sur une liste noire et condamnée d'avance.
Gourdins, nerfs de bœuf, ceinturons constituent la panoplie élémentaire des instruments de torture dont disposent les cours martiales qui commencent à fonctionner en février à Marseille et Toulouse, en avril à Paris. Les sévices s'exercent sans retenue aucune. Ici, lors d'une opération menée contre un maquis breton, un témoin oculaire, cité par Robert Aron, raconte :
On traîne un maquisard blessé dont l'une des jambes n'est plus qu'un amas de chairs meurtries et de sang coagulé. Son visage s'est recouvert d'un masque cadavérique : pourtant les miliciens ne semblent pas encore satisfaits et lui martèlent les reins à coups de crosse de mitraillette. Ailleurs, une file de détenus face au mur. Les miliciens font un va-et-vient continu derrière eux, décochent çà et là des coups de grenade à manche, de crosse de mitraillette ou de bottes. L'un, qui a à peine vingt ans, s'acharne sur un jeune rachitique pâle et boiteux, auquel il voudrait faire adopter une attitude verticale, mais le pauvre enfant ne peu. En d'autres circonstances, les miliciens se contentent d'un rôle subalterne de croque-morts au service des bourreaux nazis.
Sanglant prélude au débarquement
Résistants et miliciens de Vichy
Début 1944, sentant croître le danger d'un débarquement allié en France, les Allemands décident de nettoyer les maquis les plus importants afin d'éliminer toute menace sur leurs arrières. Comme leurs meilleures unités sont alignées sur le Mur de l'Atlantique ou en réserve tactique, ils décident de compenser leur faiblesse numérique en s'adjoignant des auxiliaires français. C'est, bien sûr, la Milice qui fournit l'appoint nécessaire. Ainsi participe-t-elle, avant juin 1944, à la plus grande opération d'envergure qui soit montée contre le maquis : l'attaque du plateau des Glières, en Savoie. G.M.R. et miliciens, postés aux issues, assurent le bouclage du dispositif tandis que les Allemands ratissent le plateau. L'action, commencée le 26 mars, tourne rapidement à une poursuite impitoyable des patriotes; ceux qui parviennent à s'échapper par les passages menant vers les vallées tombent parfois sous le feu des francs-gardes aux uniformes bleus.
Vengeance, hasard, un mois plus tard, une effroyable tuerie ensanglante encore la région : à Voiron, dans l'Isère, le chef de la Milice, Jourdan, a pour vis-à-vis un certain Durand qui a juré sa perte. Comme Jourdan, craintif, est toujours gardé et armé, Durand imagine de faire adhérer à la Milice locale quatre jeunes gens de confiance. Ayant endormi la méfiance de Jourdan, ceux-ci viennent régulièrement chez lui pour écouter les éditoriaux enflammés de Philippe Henriot à Radio-Paris. Le soir du 20 avril, comme à l'accoutumée, ils entrent et, brusquement, dégainent leurs armes : une balle dans la nuque pour Jourdan, une autre pour sa femme, une troisième et une quatrième pour les deux gardes du corps, une cinquième pour la grand-mère hurlante d'effroi, une sixième pour le gamin de dix ans cloué par la peur, une septième enfin pour le bébé dormant dans son berceau, voilà toute la maisonnée abattue de sang-froid.
Personnalités assassinées
L'assassinat de personnalités révèle le caractère impitoyable de ces représailles qui n'épargnent personne. Ainsi en est-il de Jean Zay, ancien ministre de l'Education nationale, condamné par Vichy à la détention perpétuelle pour désertion en 1940. Enfermé depuis cette date à la prison de Riom, il en est extrait le 20 juin 1944 par trois miliciens chargés de son transfert dans le Vaucluse. A partir du moment où la voiture emmène le malheureux, on perd sa trace. L'hypothèse la plus plausible porte à croire que se faisant passer pour des maquisards, les trois individus mettent Jean Zay en confiance. Lors d'une halte improvisée, celui-ci descend de voiture sans méfiance; tandis qu'il s'éponge le front et essuie ses lunettes, l'un des tueurs l'abat d'une longue rafale de mitraillette dans le dos.
Huit jours plus tard, Jean Zay est vengé : répondant à l'ordre du gouvernement d'Alger d'enlever Philippe Henriot ou de l'exécuter, les F.F.I. remplissent ponctuellement leur mission. Secrétaire d'État à l'Information du gouvernement de Vichy, l'homme à la voix d'or, comme on l'appelle, couche ce soir-là, 27 juin, dans les locaux du ministère. Malgré les appréhensions de sa femme, il refuse les services de son garde du corps. Pour lui, la nuit sera brève : après avoir intimidé, avec de faux papiers, un piquet de gardiens de la paix, après avoir menacé la concierge, les exécuteurs menés par un certain Morlot, un dur de vingt-deux ans, montent jusqu'à la chambre du ministre :
Milice !
Henriot s'approche. N'ouvre pas, hurle son épouse. Mais le ministre a déjà tourné la poignée. C'est alors la ruée.
C'est bien vous Philippe Henriot ? s'écrie Morlot, braquant son revolver.
C'est moi
Une première balle ne fait qu'érafler la joue. A la troisième, Henriot s'affaisse. Au même moment, une rafale laboure le ventre du ministre qui pousse un grand cri et meurt sur-le-champ.
La rage au coeur, les miliciens vont chercher, plusieurs jours, une victime expiatoire. Ils la trouveront bientôt en la personne de Georges Mandel. L'ancien chef de cabinet de Georges Clemenceau, ministre des P.T.T. en 1934, puis des Colonies en 1936, avait refusé de rejoindre Londres en juin 1940, afin de subir le sort de son pays. Détenu comme otage en Allemagne, il est livré à la France le 6 juillet 1944. Le 7, en début d'après-midi, après sa levée d'écrou de la prison de la Santé, deux voitures de miliciens viennent le chercher. Destination de principe : le château des Brosses à Vichy. Les autos prennent la direction de la Porte-d'Italie. Peu après le carrefour de l'Obélisque, en forêt de Fontainebleau, les deux véhicules s'arrêtent : Panne de carburateur, déclare l'un des miliciens.
Les passagers descendent pour se dégourdir les jambes. Mandel, accompagné d'un milicien du nom de Neroni, bavarde et s'enquiert des curiosités du massif forestier que son interlocuteur parait connaitre à merveille. Tout à coup, c'est le drame : un tueur débouche sur le sentier et tire une rafale. L'ancien ministre s'écroule, frappé de sept balles en plein thorax.
Exécutions sommaires à Guéret
Exécution d’otages à Guéret en 1944
A quatre cents kilomètres des côtes de Normandie, Guéret, serrée autour des murs de son église romane, connaît en ce matin du 7 juin 1944, au lendemain du débarquement allié, la griserie de la libération. Griserie d'autant plus intense qu'aucune portion du territoire métropolitain n'est alors définitivement arrachée à l'occupation ennemie et que cette délivrance est le fait des seules F.F.I., Forces françaises de l'intérieur.
De bonne heure, ce jour-là, des combats ont opposé les maquisards aux Allemands, retranchés dans deux hôtels, et aux miliciens, barricadés dans les locaux de la loge maçonnique. Après un bref mais vif engagement, Allemands et miliciens se rendent : aux premiers sont rendus les honneurs de la guerre, aux seconds la vie sauve est accordée. Les lois de la guerre sont observées; pour un temps seulement, car la population enthousiaste, libérée de sa peur, s'est mise à pourchasser les collaborateurs cachés chez eux.
A mort, vendu, salaud ! entend-on hurler de toutes parts. Alors commencent les premières exécutions sommaires : tandis que le combat du matin n'a fait qu'un tué dans les rangs de la Résistance, la fusillade de la haine couche à terre une dizaine de miliciens. Mais la vengeance n'a guère le temps de s'assouvir. Le 9 juin, dans un fracas de moteurs grondants, des camions bourrés de soldats de la Wehrmacht et de miliciens réoccupent la ville en force. Ces derniers organisent une rafle monstre qui conduit les Guérétois suspects à Limoges. Interrogatoires et tortures précèdent de peu les condamnations à mort dont les sentences n'ont, fort heureusement, pas le temps d'être exécutées en raison de la débâcle allemande.
La chasse aux collaborateurs
La chasse aux collaborateurs, cette femme (au centre) a été tondue à cause d’avoir collaboré avec les Allemands
Les soldats américains, les Tommies anglais regardent d'un air étonné ou scandalisé ces femmes, la tête et le sexe tondus, que l'on promène par les rues, encadrées de mitraillettes vindicatives, ces hommes qui, le cou pris dans le carcan d'un portrait du Führer, sont hués par la foule; ils assistent au sac des maisons habitées par les collabos; ils feignent de ne pas entendre le claquement des détonations annonçant, ici ou là, quelque exécution sommaire. Ils interviennent parfois, mais ce n'est pas leur rôle, c'est celui de la nouvelle administration gaulliste. Et puis, toujours à la poursuite des Allemands, leur passage dans les régions libérées est si bref.
Dans les villes, l'oppression de quatre années d'occupation, les privations endurées, la peur trouvent tout à coup leur exutoire dans l'explosion de la vindicte populaire. Château-Gontier, qui a connu, la veille même de sa libération, des heures affreuses marquées par l'exécution de sept Français (otages et résistants) fusillés dans la cour du collège à l'aube, 6 août, voit s'organiser, dès le lendemain, une active chasse aux collaborateurs. Comme le rapporte Marc Vallée :
Plusieurs ont réussi à se cacher ou à s'enfuir. Les autres sont arrêtés à leur domicile ou dans les endroits les plus divers où ils ont vainement essayé de se dissimuler. Sous la menace de mitraillettes, par les rues de la ville, ils sont emmenés et emprisonnés. D'autres, attachés et en cortège, sont conduits jusqu'au lieu de la tuerie. Là, ils sont obligés d'enlever, poignée par poignée, la terre fraîche jusqu'à ce que soient mis à jour les sept cadavres.
Ailleurs, quelques femmes ou jeunes filles dont la conduite fut légère avec les Allemands sont fort cruellement tondues à ras sur la place publique et leurs chevelures, ô dérision, accrochées à leurs portes.
Dans les villes, l'oppression de quatre années d'occupation, les privations endurées, la peur trouvent tout à coup leur exutoire dans l'explosion de la vindicte populaire. Château-Gontier, qui a connu, la veille même de sa libération, des heures affreuses marquées par l'exécution de sept Français (otages et résistants) fusillés dans la cour du collège à l'aube, 6 août, voit s'organiser, dès le lendemain, une active chasse aux collaborateurs. Comme le rapporte Marc Vallée :
Plusieurs ont réussi à se cacher ou à s'enfuir. Les autres sont arrêtés à leur domicile ou dans les endroits les plus divers où ils ont vainement essayé de se dissimuler. Sous la menace de mitraillettes, par les rues de la ville, ils sont emmenés et emprisonnés. D'autres, attachés et en cortège, sont conduits jusqu'au lieu de la tuerie. Là, ils sont obligés d'enlever, poignée par poignée, la terre fraîche jusqu'à ce que soient mis à jour les sept cadavres.
Ailleurs, quelques femmes ou jeunes filles dont la conduite fut légère avec les Allemands sont fort cruellement tondues à ras sur la place publique et leurs chevelures, ô dérision, accrochées à leurs portes.
Mais il y a aussi l'anonyme troupeau des civils innocents tués par un cruel destin : destin du châtelain jalousé, tels dans le Sud-Ouest , qui fut lardé de coups de couteau, arrosé d'essence et brûlé, ou le baron Reille-Soult, froidement tué à Montmorillon tandis que son château est pillé; et pourtant il avait fait du renseignement au profit des Anglais.
Destin de l'ancien combattant, fervent pétainiste, du médecin dévoué pour qui les partis n'existent pas, destin du chef d'entreprise payant de sa vie la mise à la disposition de l'Allemand de ses usines ou ateliers. Mais on meurt encore pour moins que cela : d'une imprudence verbale, d'un rendez-vous pris avec un collaborateur notoire, d'une rencontre fortuite avec l'occupant et pour des motifs n'ayant rien à voir avec la guerre.
Les gangsters de la Libération
Partout on dénonce : les lettres anonymes affluentes. Un exemple qui donnera le climat : dans le journal France-Libre du 26 août, il est écrit : Il appartient à chaque Français de faire lui-même la police dans son immeuble et dans son quartier et de signaler immédiatement tout suspect aux autorités constituées.
Malheur aux concierges ! Le fait de ne pas dénoncer, de cacher un homme en danger peut valoir à son auteur d'être étiqueté collabo. La France retrouve ses tricoteuses de la Révolution qui veulent voir du sang et des congénères humiliées. Elle retrouve ses « chauffeurs » qui pillent, rançonnent, torturent. Elle retrouve en certains lieux ses sans-culottes mangeurs de curés.
Dans la Guyenne et le Languedoc, des prêtres sont tués l'un d'eux, en Lot-et-Garonne, eut la langue et les yeux arrachés, puis fut pendu par les pieds jusqu'à ce que mort s'ensuive. Des religieuses accusées d'espionnage sont torturées.
La collaboration eut ses gangsters et ses tortionnaires. La Résistance, à son corps défendant, en sécréta aussi. Il y eut de véritables chefs de bande, des étrangers souvent, qui terrorisèrent des cantons (comme Le Coz qui fut fusillé). Ce sont eux qui, soucieux de raffinement, ont tué des hommes sous les yeux de leur famille, exécuté parfois femmes et enfants, massacré des détenus dans les prisons, fusillé des notables comme le docteur Nourrissait à Saint-Bonnet-de-Joux qui était intervenu auprès des Allemands pour sauver des otages, comme le préfet de la Lozère ou le président du tribunal de Nîmes.
Pour beaucoup, la Résistance est un paravent derrière lequel se masquent de sordides jalousies, à l'abri duquel couvent des appétits douteux : ici c'est une femme que l'on convoite, là ce sont des richesses sur lesquelles ont projette de faire main basse, ailleurs c'est un concurrent, un rival plus heureux que l'on se propose d'abattre.
La vraie Résistance s'efforça de mettre à la raison toute la lie qui s'était levée. Mais dans une telle atmosphère passionnelle, froidement désirée par les communistes et indirectement provoquée par les gaullistes qui voulaient que le peuple se lève, il était difficile que, pendant quelques mois, l'exception ne fût pas de règle.
HISTOIRE DE LA GESTAPO
Insigne des SD (Sicherheitsdienst, service de sécurité) utilisé par la Gestapo
La Gestapo, acronyme tiré de l’allemand Geheime Staatspolizei signifiant (police secrète d'État), était la police politique du Troisième Reich.
Fondée en Prusse par Hermann Göring, son pouvoir s'étendit ensuite, sous l'impulsion d'Heinrich Himmler, à l'ensemble du Reich, puis aux territoires envahis par l'Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Intégrée au Reichssicherheitshauptamt de Reinhard Heydrich, elle fut dirigée par Heinrich Müller de 1934 à 1945. Chargée de lutter contre les opposants internes ou externes, réels ou supposés, puis contre les adversaires du régime nazi ou les résistants dans les pays occupés, elle fut synonyme de terreur et d'arbitraire en Allemagne, puis dans une grande partie de l'Europe. Elle joua un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs d'Europe, notamment via son Amt B4, dirigé par Adolf Eichmann.
Active jusqu'aux derniers jours du régime nazi, elle fut condamnée en tant qu'organisation criminelle lors du procès de Nuremberg.
Le siège de la Gestapo, Prinz-Albrecht-Strasse à Berlin
Victimes de la Gestapo à Lager Nordhausen
De l'insurrection spartakiste aux actions des corps francs, de l'assassinat de Walter Rathenau au putsch de la brasserie, la République de Weimar est marquée par une profonde instabilité et de fréquentes violences politiques, au cours desquelles s'illustre notamment la Sturmabteilung du parti nazi. L'appareil d'état allemand met en œuvre une stratégie de lutte essentiellement dirigée contre les communistes et la nazis, exécutée par la police régulière, comme en Bavière, ou par la police politique, comme en Prusse. De son côté, à l'initiative d'Heinrich Himmler, le parti nazi se dote d'un service de sécurité interne, le Sicherheitsdienst, confié à Reinhard Heydrich.
Göring et la création de la Gestapo
Adolf Hitler et Hermann Göring en 1934
Pendant des semaines, j'ai travaillé personnellement à la réorganisation pour arriver à créer, moi seul, de mon propre mouvement et de ma propre initiative, le service de la Gestapo. Cet instrument, qui inspire une profonde terreur aux ennemis de l'État, a puissamment contribué au fait qu'on ne peut plus parler aujourd'hui d'un danger communiste ou marxiste en Allemagne ou en Prusse.
Hermann Göring, 1934.
Lors de l'arrivée au pouvoir des nazis en janvier 1933, ceux-ci mettent en place une politique de répression suivant trois axes : l'écartement, l'internement et l'élimination des opposants politiques en dehors de tout cadre légal, menés par la SA et la SS, notamment avec l'ouverture des premiers camps de concentration ; la mise en place d'un cadre juridique permettant de donner à la répression un cadre légal ; la création d'un organe consacré à la police politique, la future Gestapo.
Député au Reichstag et membre du Landstag de Prusse depuis mai 1928, président du Reichstag en 1932, ministre sans portefeuille, commissaire à l'aviation et ministre de l'Intérieur de Prusse dans le gouvernement d'Adolf Hitler, Hermann Göring prend les rênes de la police prussienne, la plus importante d'Allemagne, le 12 février 1933, dont il entreprend immédiatement la nazification. Dans cette opération d'écartement des policiers aux sentiments républicains, il dispose d'une aide précieuse, celle de Rudolf Diels. Chef de la section politique de la police prussienne, l' Amt IA, qui avait combattu communistes et nazis avec efficacité et énergie, Diels met ses fichiers au service du nouveau pouvoir. Dès le 22 février, Göring accroît ses forces, en nommant les membres de la SA et du Stahlhelm, policiers auxiliaires.
Immédiatement après la proclamation des lois d'urgence du 28 février 1933 pour la défense du peuple et de l'état, officiellement justifiés par l'incendie du Reichstag, la police prussienne prend part, aux côtés de la SA et de la SS à la première grande rafle d'opposant organisée à Berlin dans la nuit du 28 février au 1er mars 1933. Dès ce moment, la Gestapo pouvait agir sans restriction et sans responsabilité, pratiquer l'arrestation secrète et la détention à perpétuité sans accusation, sans preuve, sans audience. Aucune juridiction ne pouvait s'y opposer, ni ordonner la mise en liberté et réclamer un nouvel examen du dossier.
Rudolf Diels
Göring est nommé ministre-président de Prusse le 5 mars 1933, tout en conservant son poste de président du Reichstag ; c'est à ce titre qu'il fait adopter, le 23 mars, lors de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire une loi couvrant les crimes et délits commis dans une intention patriotique, complétée, le 23 juin, par l'amnistie des condamnations prononcées contre des nazis avant la prise du pouvoir.
La Gestapo est officiellement créée le 26 avril 1933 ; elle est dirigée par Göring lui-même, avec Diels comme adjoint. Dans la foulée, la Gestapo, dont les activités sont jusqu'alors officiellement limitées à Berlin, ouvre un bureau dans chaque district prussien et met en place, dès le mois de juin, un réseau de surveillance de l'opinion publique et de délation. Elle démantèle l'organisation clandestine du parti communiste mais enquête également sur les activités de la SA, perçue par Göring comme une rivale, et dont elle fait fermer ou transférer à la SS, ses camps de concentration privés. Suite aux manœuvres de Wilhelm Frick, qui n'accepte pas que la Gestapo échappe à son autorité, Diels est révoqué en septembre 1933, pour être remplacé par Paul Hinkler, alcoolique notoire ; son mandat dure moins d'un mois, avant le retour en fonction de Diels, qui fait aussitôt arrêter son éphémère successeur. Afin d'éviter la répétition de tels soubresauts, la Gestapo est officiellement soustraite des attributions du ministère de l'Intérieur, le 30 novembre 1933 pour ne relever que du ministre-président de Prusse, c'est-à-dire, Hermann Göring.
Le 1er avril 1934, Diels est à nouveau limogé, pour être remplacé, le 20 avril, par Heinrich Himmler, Göring conservant toutefois officiellement la direction de la Gestapo.
La prise en main par la SS et l'intégration au RSHA
Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich en 1939
Pendant que Göring organise la Gestapo en Prusse, Heinrich Himmler pend petit à petit le contrôle des polices des autres états allemands : en mars 1933, il est nommé préfet de police de Munich, puis, un mois plus tard, président de la police de Bavière ; dans les mois qui suivent, il prend le contrôle des polices de Hambourg, du Mecklenburg, de Lübeck, de la Thuringe. Au printemps 1934, il dirige toutes les polices allemandes à l'exception de la Prusse. Sorti vainqueur d'une lutte pour le pouvoir qui l'oppose à Kurt Daluege, le protégé de Wilhelm Frick, Himmler unifie toutes les polices allemandes dès sa nomination à Berlin et étend le champ d'action de la Gestapo à toute l'Allemagne ; à la tête du service central de la Gestapo, il nomme son plus proche adjoint, Reinhard Heydrich, déjà responsable du SD. Heydrich prend comme adjoint à la direction de la Gestapo un ancien membre de la police criminelle de Munich sous la République de Weimar, Heinrich Müller, qui s'était notamment illustré dans la lutte contre les nazis.
Le 17 juin 1936, Himmler est nommé chef de toutes les polices allemandes (Chef der Deutschen Polizei) ; il contrôle l'Ordnungspolizei de Kurt Dalueget et la Sicherheitspolizei, qui regroupe la Gestapo et la Kriminalpolizei (KRIPO), dirigée par Arthur Nebe. La SIPO est chargée de lutter contre les ennemis de l'État : la KRIPO poursuit « les individus qui par la suite de dégénérescence physique ou morale sont séparés de la communauté populaire et qui violent, dans leur intérêt particulier, les dispositions prises pour préserver l'intérêt général, la Gestapo s'occupant des individus qui, comme mandataires des ennemis du peuple allemand national-socialiste, veulent détruire l'unité nationale et anéantir la puissance de l'État.
Le, 22 septembre 1939, la SIPO est incorporée, avec le SD, au Reichssicherheitshauptamt, placé sous la direction de Heydrich, puis de Ernst Kaltenbrunner.
Missions et pouvoirs
La Gestapo a la tâche de rechercher toutes les intentions qui mettent l'État en danger, et de lutter contre elles, de rassembler et d'exploiter le résultat des enquêtes, d'informer le gouvernement, de tenir les autorités au courant des constations importantes pour elles et de leur fournir des impulsions.
Décret d'Hermann Göring du 10 février 1936.
L'absence de tout cadre légal, avant le décret de Göring, n'empêche pas la Gestapo d'agir dès 1933. Sur la base des décrets des 28 février 1933 et8 mars 1934, qui mettent en place la détention de protection (Schutzhaft), elle peut emprisonner ou interner en camp de concentration qui bon lui semble, sans limite de durée, sans chef d'accusation et sans procès. L'absence de tout contrôle juridictionnel sur les agissements de la Gestapo est officiellement confirmée le 10 février 1936, par une loi qui stipule notamment que « les ordres et les affaires de la police secrète ne sont pas sujets à l'examen des tribunaux administratifs », loi qui ne fait que confirmer un avis de la Cour administrative de Prusse de 1935, selon lequel une mise en détention de protection ne peut être contestée devant un tribunal.
L'organisation interne
De gauche à droite : Huber, Nebe, Himmler, Heydrich et Müller
Dirigée de 1935 à 1945 par Heinrich Müller, la Gestapo est organisée en 6 départements(eallemand Amt, au singulier), qui comportent plusieurs sections. La plus connue d'entre elles, la section B4, dirigée par Adolf Eichmann, sera le principal organisateur de l'extermination des Juifs d'Europe.
Amt A : adversaires du nazisme
Communistes, marxistes et organisations apparentées, propagande illégale ou hostile
Contre-Sabotage et mesures de sécurité générale
Réactionnaires, libéraux, légitimistes, émigrés
Service de sécurité, prévention des attentats
Amt B : églises, sectes religieuses, Juifs et francs-maçons
Catholicisme politique
Protestantisme et sectes
Autres églises et francs-maçons
Juifs
Amt C
Fichier central, gestion du personnel, surveillance des étrangers
Internements de protection
Presse et publications
Affaires du parti
Amt D : territoires occupés et travailleurs étrangers en Allemagne
Protectorat et Tchécoslovaques résidant dans le Reich
Gouvernement général et Polonais résidant dans le Reich
Ennemis de l'état étrangers
Territoires de l'Ouest : Pays-Bas, Belgique, France, Luxembourg, Alsace, Lorraine, Norvège, Danemark
Amt E : Contre-espionnage
Problèmes généraux et contre-espionnage dans les usines du Reich
Problèmes économiques généraux
Pays de l'Ouest
Pays nordiques
Pays de l'Est
Pays du Sud
Amt F
Police des frontières
Passeports
Cartes d'identité
Police des étrangers
Amt P : Relations avec les polices étrangères
Referat N (1941) : centralisation des renseignements
Le rôle de la Gestapo. L'élimination des opposants (1933-1939)
Au travers de l'appareil du parti nazi, du Gauleiter au Blockleiter, la Gestapo dispose en Allemagne, de dizaines de milliers d'oreilles et d'yeux attentifs.
Si le rôle réel de la Gestapo dans l'incendie du Reichstag est controversé, elle est bien au centre la préparation de la nuit des longs couteaux. Elle contribue à monter le dossier du faux complot de Ernst Röhm contre Adolf Hitler et à rédiger la liste des personnes à assassiner; elle participe également aux meurtres et commet notamment ceux de Herbert von Bose, de Kurt von Schleicher et de son épouse et de Erich Klausener.
Désormais indépendante, la SS peut mener à bien sa besogne. Le parti nazi étant reconnu parti unique, la Gestapo continue à traquer sans relâche les opposants politiques, en particulier les membres du KPD. De même, ceux qui n'entrent pas dans l'idéal du parti que les nazis appellent la Volksgemeinschaft (la communauté du peuple), sont rapidement repérés et interceptés. On commence alors à s'intéresser aux minorités en particulier aux Juifs. Le parti va mettre à la disposition de la Gestapo une base légale pour multiplier les arrestations : le 19 septembre 1935, sont votées les lois de Nuremberg dans lesquelles il est disposé que tout mariage entre juifs et allemands est strictement interdit. Un climat général de terreur s'est installé en Allemagne. Alors que la police apparaît lors des films de propagande comme proche du peuple, les dénonciations se multiplient. Durant l'été 1936, Himmler est nommé Chef der Deutschen Polizei (chef de toutes les polices d'Allemagne) mais c'est Heydrich, son bras droit qui la dirige véritablement. En outre, le ministère de l'Intérieur possède encore un contrôle important. Les intellectuels SS ont un rôle de plus en plus déterminant au sein de la machine nazie à partir de la fin des années 1930. Werner Best, juriste et technocrate SS, est l'un d'eux. Il assiste Heydrich à la tête de la Gestapo jusqu'en 1940. Franz Six est quant à lui le concepteur du Gegnerforschung (section de la Gestapo qui traque les ennemis du Reich) et recruté par Heydrich au sein du SD.
En 1938, suite à l'Anschluss, les dirigeants de la gauche autrichienne sont arrêtés. L'année suivante, la Gestapo établit une liste des opposants tchèques à supprimer.
La poursuite de la répression
Les oppositions grandissent contre la brutalité du régime policier. L'association de la Rose blanche, dirigée par Sophie et Hans Scholl, critique la boucherie de Stalingrad ainsi que les déportations. Dénoncés, ils sont arrêtés par la Gestapo puis décapités le 22 février 1943 près de Munich.
La police secrète traque les auditeurs des radios étrangères, dont l'usage est strictement interdit, reconnu comme un acte de trahison. Les amateurs de musique américaine (jazz et swing) sont également pourchassés puisque le régime n'autorise pas l'écoute de la musique nègre. Enfin, les mariages mixtes sont analysés au peigne fin. À Francfort, Heinrich Baab ordonne l'arrestation des Juifs mariés avec des Aryens : la ville va connaître des dizaines de milliers d'arrestations (1941-1943). Au mois d'août 1943, Himmler est nommé Reichs-und Preussischer Minister des Innern (Ministre de l'Intérieur) : il est désormais le maître incontesté du régime policier allemand.
La répression dans les territoires occupés
À L’est
Au cours de l'année 1939, les dirigeants de la Gestapo forment leurs hommes à une prochaine entrée en guerre. Müller coordonne l'opération Tannenberg qui sera un prétexte pour attaquer sans scrupule la Pologne en septembre.
Le 4 juin 1942, Heydrich décède suite à un attentat à Prague. Cet événement intensifie la violence et les arrestations. Himmler reprend provisoirement la direction du RSHA jusqu'en janvier 1943, période à laquelle Ernst Kaltenbrunner lui succède. En représailles à la mort, près de la capitale tchèque, les SS et la Gestapo rasent de la carte le village de Lidice en fusillant tous les hommes et en déportant les femmes et les enfants.
En Pologne, par exemple à Lublin, le chef de la Gestapo, Oswald Gudenlach fait assassiner des dizaines de milliers d'innocents et organise une gigantesque rafle antijuive entre le 3 et le 4 novembre 1943, plus de 43.000 personnes sont assassinées.
À L’ouest
À Paris, c'est l'Obersturmbannführer Kurt Lischka qui dirige la Gestapo à partir de l'automne 1940 en s'installant rue des Saussaies (8e arrondissement). Le président du Conseil français, Pierre Laval, se met d'accord avec les nazis pour mener efficacement l'arrestation des Juifs par la police française : au total 80 000 Juifs français sont déportés.
Siège de la Gestapo durant le seconde guerre mondiale à Nice
La déportation et l'extermination des Juifs d'Europe
Entre l'automne 1939 et le printemps 1940, Hitler veut gagner la guerre au plus vite. Il ordonne l'élimination de 70 000 personnes par les Einsatzgruppen (commandos SS) en Europe de l'Est en particulier en Ukraine et en Biélorussie. Les unités SS et la Gestapo prêtent main forte à ces unités mobiles pour exterminer les hommes en âge de combattre.
Avec la réquisition des moyens de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), c'est notamment au sein de la Gestapo dans le service IV.B.4 dirigé par Adolf Eichmann, que sont organisés tous les transports de prisonniers vers les camps de concentration. C'est également elle qui procède aux arrestations des Juifs - qui, désormais doivent porter l'étoile jaune - et des opposants politiques en Allemagne et dans les territoires conquis.
Le 31 juillet 1941, Heydrich établit un plan pour l'élimination des Juifs à grande échelle: l'opération Reinhard. L'objectif est de planifier l'extermination de 2 millions de Juifs polonais. Durant l'automne, Himmler ordonne sa mise en place. Le 20 janvier 1942, Müller est présent à la conférence de Wannsee, durant laquelle on coordonne l’Endlösung (Solution finale). Le projet est diffusé au sein de la Gestapo, auxiliaire incontournable de sa mise en place. Heydrich veut faire de ses policiers non plus les modèles de la Volksgemeinschaft, mais des policiers politique, véritables acteurs de la Solution finale.
Portrait de Jean Moulin assassiné par les Allemands en 1943
La Gestapo fonctionne sans aucun tribunal et décide elle-même des sanctions à appliquer. Elle s'est rendue célèbre, en Allemagne d'abord, puis dans toute l'Europe occupée, par la terreur implacable qu'engendrent ses procédés. Elle incarne l'arbitraire et l'horreur des forces nazies. La Gestapo est une police des esprits, ayant des informateurs dans toutes les couches sociales de la population. Aux policiers allemands ou aux 1 500 policiers présents sur le territoire français, s'ajoutent 40 000 auxiliaires d'origines diverses, y compris le grand banditisme.
En avril 1942, Himmler obtient d'Hitler que les pouvoirs de police soient transférés des militaires au général de police SS Karl Oberg. La Gestapo peut alors appliquer à la France les méthodes employées en Allemagne et dans les autres territoires occupés. Dès le 10 juin, le pouvoir central nazi lui recommanda d'utiliser la torture lors des interrogatoires pour arracher des aveux et des informations aux prisonniers récalcitrants. C'est le cas notamment du chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie qui sera le bourreau de Jean Moulin.
Principaux agents et officiers de la Gestapo
Heinrich Baab Heinrich Himmler Franz Stangl (Gestapo autrichien)
Reinhard Heydrich Klaus Barbie Wielen maximum
Kurt Lischka Werner Best Hermann Göring
Helmut Knochen Karl Boemelburg Siegfried
Heinrich Müller Rudolf Diels Franz Six
Karl Oberg Adolf Eichmann Théo Dannecker (chef de la section IV-J)
Pierre Paoli Gerhard Flesch
Henry Oliver Rinnan Hans Bernd Gisevius
Walter Schellenberg Oswald Gudenlach
Karl Eberhard Schongarth , Herbert Kappler
Personnalités exécutées par la Gestapo
Marc Bloch, historien français
Jean Moulin, chef de la Résistance française
La Geheime Staatspolizei, créée par Hermann Goering en 1933, n’est à l’origine qu’une sous-division de la police judiciaire, issue de la police politique mise en place sous la République de Weimar. Après 1933, la Gestapo émerge très vite comme l’instrument de répression privilégié du nouveau régime : dès le 27 février 1933, deux jours après l’incendie du Reichstag, commencent les épurations. Lorsqu’en 1943 la Gestapo passe sous la direction de Himmler et de Heydrich, elle devient la police politique de l’empire SS. Sa participation à l’élimination du chef des SA, Ernst Röhm, confirme son allégeance absolue à Hitler et
renforce sa position. Elle est désormais la pièce maîtresse du système policier du Reich.
Aujourd’hui l’Allemagne nous appartient, et demain le monde entier. Suivant à la lettre ce chant nazi, la Gestapo étend à partir de 1939 son emprise à toute l’Europe. Aux ennemis du Reich identifiés dès 1933 s’ajoutent de nouvelles catégories : (bolcheviks), espions, résistants. Implantée partout, la police secrète allemande enquête, rafle, emprisonne et déporte. Sa réputation d’omnipotence et d’omniscience, relayée par la propagande, se répand sur tout le continent. Un mythe que les nombreux suiveurs, dénonciateurs et autres hommes de main, y compris les collaborateurs français, entretiendront longtemps après la fin de la guerre pour tenter d’échapper à leurs responsabilités
Au service de la terreur
Comment la Gestapo a-t-elle imposé la terreur au-delà des frontières de l’Allemagne ? Ce deuxième volet revient sur les étapes de l’amplification des pouvoirs de la police secrète des nazis. Alors que, sur le front de l’Est, elle organise des commandos de la mort, une nouvelle unité spéciale est créée sous la responsabilité d’Adolf Eichmann en liaison avec le chef de la Gestapo, Heinrich Müller. Sa mission : organiser l’arrestation et la déportation des juifs. Peu à peu, la Gestapo fait également main basse sur le contre espionnage, normalement dévolu aux services secrets, et s’enorgueillit de ses succès notamment du démantèlement du réseau Orchestre rouge. Mais, après la défaite de Stalingrad début 1943, les victoires se font rares et la Gestapo subit des revers : l’assassinat du capitaine SS Heydrich en juin 1942, l’attentat (manqué de peu) contre Hitler en juillet 1944. Des échecs qui n’entament pourtant pas sa réputation auprès du Führer et des dignitaires nazis. Au contraire : la Gestapo a désormais carte blanche. Et les Allemands, victimes des exactions commises par des groupes de policiers incontrôlés, en subissent de plein fouet les conséquences.
Fin 1944, la Gestapo a recentré ses actions sur l’Allemagne. En 1945, dans l’ambiance d’apocalypse qui marque les derniers mois du Reich, la machine à semer la terreur échappe à tout contrôle. Plus la fin approche, plus il est risqué, que l’on soit militaire ou civil, d’exprimer le moindre doute sur la victoire finale. Le simple bon sens passe pour du défaitisme. Et la Gestapo pour qui, désormais, chacun est un coupable potentiel, frappe à coups redoublés. Cela n’empêche pas la plupart de ses hommes, des hauts dirigeants aux simples fonctionnaires, de se préparer à l’après-guerre. Ils effacent les traces de leurs agissements, détruisent les preuves de leurs exactions. Après 1945, il ne reste qu’une infime partie des milliers de dossiers constitués par la police secrète. Les hommes de la Gestapo changent d’identité ou prennent la fuite, grâce à des réseaux d’entraide qui leur permettent de gagner des pays sûrs, pour la plupart en Amérique latine. Ceux qui n’ont pas quitté l’Allemagne font valoir, quelques années après la fin de la guerre, leur statut de fonctionnaire. Ils sont réintégrés, souvent à des postes de commandement. Chez les Alliés, après quelques procès difficiles à instruire et quelques exécutions, le pragmatisme l’emporte. Bon nombre d’anciens de la Gestapo trouvent à s’employer dans les services secrets de divers pays. Au grand dam des chasseurs de nazis, comme Simon Wiesenthal, et de tous ceux qui n’acceptent pas que ces criminels échappent aux poursuites.
Le 93 rue Lauriston
A dix ans, on lui aurait donné le bon dieu sans confession.
Mon oncle Raymond Monange, enfant des banlieues, abandonna très jeune son métier de peintre en bâtiments à Montreuil pour celui plus lucratif de proxénète à Pigalle, puis gestapiste à la Carlingue. J’ai découvert un peu par hasard son histoire qui avait été soigneusement occultée par notre famille. Condamné une première fois, en 1931, pour proxénétisme, il choisit l’engagement aux Bats-d’Af pour échapper à sa peine. Il y connut à Tataouine tout le gratin du futur grand banditisme.
Après la fin de la drôle de guerre, il fit son entrée dans la bande à Lafont du 93 rue Lauriston et participa comme cadre, à la création de la Brigade nord-africaine, BNA, sous les ordres de Lafont, et équipé par Joanovici, aux exactions, sous l’uniforme allemand, contre les maquis de Tulle et Périgueux.
Impuni à l’issue de la fin de la guerre il reprit ses petites affaires ordinaires et fit quelques coups de main avec la bande de Pierre Loutrel alias Pierrot le fou. Il y retrouva ses anciens amis des Bats-d’Af Abel Danos et Jo Attia entres-autres. Arrêté un peu par hasard, sous une fausse identité, il fut identifié et inculpé pour intelligence avec l’ennemi. Condamné à mort, il fut fusillé au fort de Montrouge, le 13 mars 1952 en même temps que son complice Abel Danos. Obséquieux envers Abel Danos dit (Le Mammouth), dans le milieu, on appelait Raymond : (La Soubrette).
Histoire de La soubrette
Engagé volontaire à l’âge de 18 ans, dans la Légion Etrangère, il est mobilisé en 1939 comme sous-officier volontaire dans les Corps Francs, décoré de la croix de guerre, et cité à l’ordre du régiment.
Démobilisé, à la fin août 1940 il travaille comme peintre avec son père l’Auguste. Il retrouve Klen, d’origine allemande, qu’il avait connu avant la guerre aux Bats-d’Af, qui vit du produit de la prostitution et de trafics avec les Allemands. Monange d’après une de ses maîtresses aurait d’abord refusé de se mettre au service des Allemands.
Aux Bats-d’Af Raymond en 1933
Puis en janvier 1942 il est arrêté comme souteneur par la police française et condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de la Seine il est relaxé par la cour d’appel de Paris.
Détenu à la Santé jusqu’en octobre 1942 il aurait été mis à la disposition des autorités allemandes et incarcéré à la section des détenus politiques. Ce serait sur l’intervention de Klen qu’il aurait été libéré en janvier 1943 de la prison du Cherche-Midi.
Il fêta sa sortie de prison au cours d’un festin avec Klen, sa maîtresse et deux autres prostituées, le même jour Klen lui remit la somme de dix mille francs en présence de son hôtelier qui connaissait déjà Klen comme un actif agent de la Gestapo. Celui se vantait d’avoir déjà été condamné à mort en 1940 par un tribunal militaire français pour sabotages et reconnaissait avoir largement mérité sa condamnation.
D’après cet hôtelier Klen avait sous ses ordres de nombreux souteneurs du quartier de Barbès dont Monange et leurs activités s’exerçaient particulièrement contre les israélites et dans les affaires d’or ou de bijoux. L’appartenance de Monange à la police allemande semble démontrée par un rapport rédigé de sa propre main le 26 novembre 1943 et adressé à son patron Klen dans les circonstances suivantes.
Le 26 novembre 1943 Monange est arrêté par la police française parce qu’il circulait sur la voie publique après l’heure du couvre-feu. Il exhibe alors un Ausweis délivré par la Gestapo de la rue des Saussaies, non validé pour la période présente.
Après avoir pris contact avec la Feldgendarmerie, la Police reçu l’ordre de le libérer à 5 heures du matin. Aussitôt après il relate l’incident dans un rapport adressé à son chef Klen, qui fut retrouvé au domicile de ce dernier, il y signale l’attitude germanophobe des policiers français et d’une autre personne retenue avec lui au commissariat.
L’hôtelier de Monange a reconnu formellement l’écriture de Monange sur ce rapport et signalé par ailleurs que Monange et Klen ont travaillé un certain temps ensemble, mais qu’ils se sont séparés par la suite, Monange reprochant à Klen de garder par de vers lui le produit de leurs perquisitions. Les deux hommes ne se cachaient nullement pour parler de leurs exploits en public et l’hôtelier vit à deux reprises Klen remettre dix mille francs à Monange.
C’est à la suite de leur séparation que Monange passe au service de Lafont-Chamberlain. Monange prétend qu’il passa au service de Lafont pour échapper au STO et au marché noir jusqu’à la fin mars 1944.
Sollicité alors par deux agents de la rue Lauriston il aurait été contraint de se rendre chez Bonny ou il fut présenté à Lafont, qui le mit dans l’alternative d’être remis aux autorités allemandes ou de servir en uniforme allemand, en qualité de sous-officier dans la légion nord-africaine qu’il venait de créer. Pour lutter contre le maquis dans la région de Limoges Tulle et Périgueux.
La brigade nord-africaine
Les quatre sous-officiers et officiers français, en uniforme allemand encadraient des hommes de troupes nord-africains habillés en costume de ski bleu marine. Leur solde était de 5000f par mois pour les hommes de troupe et de 5500f pour les caporaux, les armes étaient fournies par les allemands l’argent par les SS et l’équipement par Joanovici.
Le commandement fut confié à Lafont qui avait le grade de capitaine, Bonny était plus spécialement chargée des interrogatoires des patriotes arrêtés qui étaient contraints aux aveux sous l’action de mauvais traitements ou de la torture en baignoire. Nombre d’entre eux furent déportés, quelques-uns exécutés sur place. Des pillages de grande envergure furent organisés jusqu’à la fin 1944, terrorisant les habitants qui n’osèrent plus sortir de chez eux.
Le départ de Paris eut lieu le 11 mars 1944 et la légion fut divisée en cinq sections, une vers Montbéliard, l’autre sur Périgueux commandée par Villaplana, et les trois dernières sur Tulle sous le commandement de Lafont, le groupe de Tulle auquel appartenait Monange fut cantonné à l’hôtel St Martin. La femme de chambre de l’hôtel rapporte que Raymond aurait déclaré : « Pour moi plus il y a de bagarres, plus je suis content ».
Café de la Rotonde à Tulle : le 18 mars 1944 un groupe de cinq amis fête l’enterrement de la vie de garçon de l’un d’eux. Vers 15 heures survint un individu armé d’un revolver revêtu de l’uniforme allemand et accompagné d’un Nord-Africain qui fit sortir les consommateurs et les aligna sur le pont de la Vézère. Leur disant les bras levés ou je vous abats comme des chiens, il vérifia leurs papiers d’identités, en les injuriant et en frappant certains d’entre eux à coups de pied. Il les laissa se disperser. Sur présentation de sa photographie, Monange fut formellement reconnu en 1949.
Café le bon vin: deux résistants qui consommaient, dans ce café, le 18 avril 1944, furent appréhendés et conduits à l’hôtel St Martin, au vu de sa photographie, ils reconnurent Monange comme étant un de ceux qui avaient procédé à leur arrestation, puis à leur interrogatoire à l’hôtel St Martin. L’interrogatoire fut conduit par Monange avec beaucoup de brutalité, pour leur faire avouer où était l’emplacement d’un maquis, il les frappa à coups de poing et de cravache au visage et à la tête. Alors qu’un des membres de la légion tentait de le calmer, il s’écria : Ah vous ne savez pas ce que c’est que la Gestapo, et bien je vais vous l’apprendre moi. Aucun des deux résistants ne parla, un fut relâché après huit jours, l’autre fut enfermé au fort de Vincennes d’où il s’évada.
Le 18 avril 1944 vers 17 heures, Georges Bressoux., âgé de 24 ans, circulait à proximité de la gare de Tulle. Il fut abordé par deux individus qui lui demandèrent ses papiers. L’un d’eux était armé d’une mitraillette, l’autre portait un uniforme allemand c’était Monange, les papiers n’ayant pas paru en règle ils voulurent lui passer les menottes, il refusa en protestant de son innocence. Monange le frappa de ses poings et avec les menottes, pendant que l’homme en arme tirait une rafale de mitraillette dans ses jambes. Monange essaya de le remettre sur ses pieds, mais la victime était incapable de tenir debout. Il fut hospitalisé du 19 avril au 16 août 1944 pour fracture de la jambe droite par balles, blessures par balles à la jambe gauche et contusions à la tête par coups de crosse.
Le 19 mai 1948 il fut réformé définitivement, avec pension permanente. Son père a déclaré que, depuis cette époque, son fils ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales, ses blessures ont provoqué chez lui des troubles cérébraux et de fréquentes pertes de mémoire. Avant cette agression, il travaillait à la préfecture de Tulle et, était promis à un brillant avenir, titulaire de ses deux bacs, il préparait sa licence en droit.
Madame Sol est arrêtée, à son domicile le 4 mai 1944 à Brive, par deux Allemands et deux Français de la Gestapo, dont Monange, qui lui volèrent une montre en or et un poste de TSF, au cours d’une perquisition, elle fut conduite à l’hôtel St Martin, et ne recouvra sa liberté qu’au bout de trois semaines. Au cours de son transfert Monange lui décrivit les supplices qui seraient infligés à son mari, résistant, en cas d’arrestation : ongles et yeux arrachés, oreilles coupées, sans compter le reste, il ajouta que dans trois mois les maquis auraient disparu grâce à l’énergie de la répression.
Les époux Rheims qui faisaient partie de la résistance furent arrêtés le 6 mai 1944 à Bessac en Corrèze par des agents de la gestapo, détenus pendant quatre mois à la prison de Limoges, ils furent libérés par l’avance alliée, confrontés avec Monange, ils le reconnurent formellement comme un de ceux qui avaient participé à leur arrestation et qui assuraient leur garde.
Monange quitta Tulle, à la fin mai 1944, sur l’ordre de Lafont pour arriver à Périgueux, pour prendre le commandement de la légion nord-africaine, comme lieutenant, en remplacement de Villaplana. Son arrivée à Périgueux a été marquée par une plus grande activité dans la lutte contre la résistance par des opérations menées par la légion ou la police allemande. Le Pc de la légion était situé au siège de la BNCI de Périgueux, tous les témoins entendus indiquent que le chef était le lieutenant Raymond.
Une vingtaine d’otages furent fusillés à Brantôme par un peloton d’exécution de la légion nord-africaine, commandés par un sous-officier, la présence en leur seing de Raymond n’est pas établie.
En juin 1944 à Mussidan 49 otages furent fusillés par un peloton de Nord-Africains en présence de cinq ou six Français en uniforme allemand, nul doute que le responsable de la brigade, Raymond ait été absent.
Le 20 juin 1944 au Château de la Feuillade, ou trois maquisards trouvèrent la mort, le même jour au Château Levêque et à la chapelle Gonnagay où plusieurs patriotes furent arrêtés la présence de Raymond est établie. Le sieur Pasquier, instituteur arrêté par Monange, ce jour-là a confirmé la présence de Raymond, au cours d’une halte à la Chapelle Gonnagay, Monange lui avait déclaré : Je suis le chef de la légion arabe, je n’ai pas peur du maquis, d’ailleurs j’ai appartenu à la Légion Étrangère.
Madame Godichon atteste la présence du lieutenant Raymond vers 11 heures au village de Pessard, commune de Château-Levêque qui fut encerclé par la brigade nord-africaine, pendant que Raymond se livrait à une fructueuse perquisition chez les Coraval, les deux Allemands de la Gestapo interrogeaient le père, la mère, la fille. Ils fusillèrent le père et arrêtèrent la fille qui fut conduite dans un des camions de l’expédition. Vers 15 heures, Raymond se trouva à la Chapelle Gonnagay où furent arrêtées deux autres personnes dont le sieur Rate qui eut sa maison pillée.
Ce même jour, Madame Lagarde, garagiste est sommée d’ouvrir son garage, accusée de sabotage et malmenée, pendant qu’un jeune passant voulant prendre sa défense est roué de coups. Furieux de ne pouvoir dépanner leur voiture, Raymond et un certain Willy qui l’accompagnait tirent des coups de revolver dans les fenêtres avant de se retirer.
Le 19 juin 1944 un veilleur de nuit de l’hôpital de Périgueux fut arrêté par Raymond, dans un café sous prétexte d’avoir insulté la police allemande. Giflé et battu tant par Raymond que par ses Nord-Africains, il fut gardé pendant quatre heures à leur PC.
Arrêtée le 10 juillet 1944 Madame Bernard fut conduite devant Monange qui l’interrogea sur le maquis dont son mari devait faire partie. Comme elle ne répondait pas de manière satisfaisante, après l’avoir menacée de son revolver, il la frappa d’un grand coup de nerf de bœuf au visage, puis il lui remit le canon de son revolver sur la tempe comme elle persistait dans son silence, il lui dit : Ton mari est mort, je te le montrerai.
L’interrogatoire dura encore une heure et demie en présence de la sœur de Madame Bernard. Elles furent enfermées toutes deux dans une étroite cellule durant 3 jours, attenante au bureau de Monange. Ceci leur permit d’entendre un interrogatoire d’une extrême violence, ou un homme qui devait appartenir au maquis d’Hercule était sommé d’en indiquer l’emplacement.
Les deux femmes affirment que Raymond était déchaîné pendant que la personne arrêtée poussait des hurlements suivis de gémissements plaintifs, puis était conduit à la douche d’où elle sortait au bout d’une heure claquant des dents et paraissant épuisée. De là elle fut conduite à un autre étage.
Le 9 juillet 1944 Monange perquisitionne chez les époux Pradier avec quelques hommes dans l’espoir d’arrêter leur fils. Ils revinrent à plusieurs reprises sans trouver le jeune homme qui avait rejoint le maquis. Ils firent main basse sur divers objets et sur une somme de 500 F. Un soir Monange menaça Madame Pradier en ces termes : Si vous ne voulez pas me dire où est votre fils et bien je le tuerai et je viendrai vous dire Madame, j’ai tué votre fils .
Le 6 juin 1944 Monange tenta d’arrêter Madame Gilles dont le fils et le mari avaient rejoint le maquis, il déclara à ses employés. Il me faut la patronne morte ou vivante, il visita les pièces, revolver au poing et brutalisa une servante. Il revint le surlendemain et porta des coups à une bonne qu’il fit rouler dans l’escalier.
À Périgueux, Monange voulut réquisitionner un gardien de la paix de service en ville afin de l’obliger à escorter un de ses détenus à la prison. Devant le refus de ce dernier, il le désarma, l’arrêta et ne le relâcha que sur l’intervention du brigadier de police qui échangea avec lui des propos assez vifs. Il concevait ainsi ses relations avec la police française, Vous êtes tous à notre disposition et vous devez savoir que nous pouvons agir sur vous comme bon nous semble Ce brigadier remarqua que Monange avait les mains pleines de sang, venant, parait-il de corriger des nord-africains.
Le 10 août 1944 Monange rédige un rapport à l’intention du général Arndt, lui signalant la désagrégation de la légion nord-africaine par suite de nombreuses désertions.
Il est arrêté le 31 octobre 1946, il tente de faire usage d’un pistolet dont il était porteur et opposa une vive résistance aux agents chargés de l’arrêter. Il possédait une fausse carte d’identité et de faux certificats de la Résistance.
Il fut condamné le 3 janvier 1947 par le tribunal correctionnel de la Seine à quatre mois d’emprisonnement pour port d’arme prohibée et rébellion. On découvrit lors de sa détention ses activités de Gestapiste. Il fut transféré à la prison de Fresnes dans l’attente de son procès.
Procès, Cour de Justice de la Seine du 13 au 17 mai 1949
Entre le 16 juin 1940 et la date de la libération entretient, étant français une intelligence avec l’ennemi, condamne Raymond Alfred Monange à la peine de mort, prononce la confiscation des biens divis ou indivis présents et futurs, constate qu’il est en état de dégradation nationale.
Condamné Abel Danos aux mêmes peines.
Condamné Paul Victor à 20 ans de travaux forcés.
Un recours en grâce a été dressé le 27 juin 1949, pour Monange, par Maître Yvonne Pige
L’avocat de Danos interjette appel.
Le 22 décembre 1950 un courrier du directeur des grâces indique que l’arrêt Danos a été cassé le 4 mai 1950 et ordonne un supplément d’information. Le 29 décembre 1950 Raymond Monange est à Fresnes. Le 24 février 1951 un courrier indique que la décision concernant Monange est suspendue durant l’information supplétive de Danos.
En janvier 1951, l’assistante sociale de Fresnes demande un meilleur régime pour Danos et Monange, depuis deux ans et demi ils portent les chaînes et ne peuvent plus cantiner, ils demandent une nourriture améliorée comme les années précédentes.
Le 30 mai 1951, une note du ministère de l’intérieur informe la prison d’un projet d’évasion avec complicité extérieure, un revolver serait déjà en leur possession et qu’un second doit leur parvenir prochainement.
La grâce présidentielle est problématique, Danos est actuellement poursuivi devant plusieurs parquets pour assassinats et vols qualifiés il est spécialiste de l’évasion, il s’est enfui de Fresnes en février 1942 et du dépôt de la préfecture de police en janvier 1945, il a trois meurtres d’agent de la force publique à son actif (Signé commissaire Chenevier).
Le 17 décembre 1951 une lettre signale une grève de la faim commencée le 6 décembre 1951, et terminée le 17.
Le 27 février 1952 un décret de Vincent Auriol refuse la grâce.
Le 14 mars 1952 à 7 h 26 Raymond Monange et Abel Danos sont passés par les armes au fort de Montrouge.
HISTORIQUE DE LA RESISTANCE
FRANCE ÉTÉ 1940
La France de l'occupation 1940-1944
En 1940, la France subit les conséquences d'un véritable effondrement national. Elle est désormais occupée, sur près des 2/3 du territoire, par l'armée allemande, dont la mission est de (maintenir l'ordre) et "d'utiliser les ressources du pays pour les besoins de la Wehrmacht et de l'économie de guerre allemande". Le gouvernement français, dirigé par le maréchal Pétain et qui siège à Vichy, est reconnu par l'Allemagne et l'ensemble des grands pays (sauf l'Angleterre) comme le gouvernement légal de la France. Il entreprend très rapidement une refonte totale des institutions du pays. Cette Révolution nationale établit au régime dictatorial et d'une société hiérarchisée où toute l'autorité émane du Maréchal, présente comme le Sauveur, apte notamment à protéger les Français face aux exigences allemandes.
Juin 1940, le drapeau nazi flotte sur Paris sous l'occupation.
Les Français perdent ainsi toutes les libertés acquises au cours de l'histoire. En même temps, en zone nord, l'omniprésence du drapeau à croix gammée rappelle durement l'humiliation subie et la perte de l'indépendance nationale.
C'est le refus d'accepter cette situation qui va conduire des hommes et des femmes à engager, volontairement, sous des formes diverses, ce combat qu'on appellera la Résistance.
Premiers pas de la Résistance
été 1940 - été 1941
Affiche apposée sur les murs de Londres en juillet 1940. Cet "appel aux armes" est bien souvent confondu avec celui du 18 juin 1940 uniquement lu à la BBC.
La Résistance commence très modestement. Elle se crée, en effet, dans un pays désorganisé, traumatisé, pris en main durement par l'occupant nazie et Vichy.
Les premiers actes de résistance, au moment même où s'installe la Wehrmacht, sont individuels et spontanés : coups de colère, sabotages (coupures de fils téléphoniques), ramassage d'armes abandonnées, aide fournie à ceux qui sont particulièrement menacés : prisonniers de guerre, ressortissants britanniques, Alsaciens et Lorrains qui refusent la germanisation).
Puis vient le temps de construire des fondations : chercher ceux qui sont susceptibles d'agir, s'organiser clandestinement, déterminer l'action à entreprendre.
Affronter directement la Wehrmacht est naturellement impossible sur le territoire français. C'est en Angleterre que va d'abord se reconstruire une armée française, à l'initiative du général de Gaulle : les F.F.L. (Forces Françaises Libres) qui entament le combat dans l'Empire.
Montoire, le 24 octobre 1940, Hitler et Pétain se rencontrent sur la ligne de démarcation et officialisent la collaboration entre les deux états.
Sur le territoire français, les premières formes de résistance sont variées, en rapport avec la personnalité, l'expérience, les conceptions philosophiques et politiques des résistants de la première heure.
Cependant, sous une forme embryonnaire, la plupart des actions de résistance sont présentes : contacts avec les services de renseignement anglais ou de la France Libre, filières de passage et d'évasion, mise en place d'instruments de combat. Le plus caractéristique, cependant, est sans doute le refus de la mise au pas, par la réactivation des pratiques démocratiques interdites.
Affiche de l'occupant, 1940.
C'est le cas, notamment, en milieu ouvrier. Pour se défendre contre la dégradation dramatique des conditions de vie et de travail, se forment, sous l'impulsion des communistes, des Comités Populaires engageant actions revendicatives, grèves, organisant des manifestations (notamment de femmes) ; actions totalement interdites et vigoureusement sanctionnées car si modestes soient-elles, elles brisent le calme social indispensable à la réussite des projets allemands et vichystes.
Annonce publique de la condamnation à mort du général de Gaulle par un tribunal militaire de l'Etat Français. In, Le Petit Dauphinois, 3 août 1940.
La naissance d'une presse clandestine est, dès le début, un aspect essentiel de la Résistance. Ordonnances allemandes et lois françaises interdisent et sanctionnent l'expression de toute pensée libre. Pour contrer la désinformation, les mensonges, les illusions, massivement répandus par les radios et les journaux légaux, les résistants vont braver la répression pour faire entendre la parole clandestine. Aux émissions en français de la B.B.C., s'ajoutent des feuilles volantes, diverses plus ou moins permanentes, dont certains constituent déjà de véritables périodiques.
Brochure officielle de l'occupant établissant la liste de tous les livres interdits, septembre 1940.
Emiettée, fragile, exploratoire, cette première Résistance apparaît très modeste. Elle est pourtant décisive car elle dresse les premiers obstacles à l'exploitation et à la résignation du peuple français. Et les deux grandes actions qui se déroulent dans cette période montrent bien les potentialités du mouvement qui naît : le 11 novembre 1940, à Paris, où s'affirme l'esprit de résistance et les convergences possibles entre courants différents ; la grève des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais, qui a mobilisé toute une population, et montre l'importance du front économique et social dans le combat national.
Annonce de la condamnation des mineurs arrêtés pendant la grande grève des mineurs du Nord et du Pas de Calais en mai et juin 1941. Affiche de l'occupant, juin 1941.
Au tournant de la guerre
été 1941 - hiver 1942/43
La Résistance va se développer en rapport avec l'évolution de la guerre, qui se répercute aussi en France.
Le premier verrou est franchi avec le premier grand tournant de la guerre. L'agression allemande contre l'U.R.S.S. (22 juin 1941, puis l'agression japonaise contre les Etats-Unis (8 décembre 1941), changent les dimensions et la nature de la guerre : l'Allemagne nazie doit désormais affronter une coalition d'Etats puissants qui combattent pour la liberté des peuples et des nations. Dans cette coalition, la France est représentée par le C.N.F. (Conseil National Français) créé, à Londres, le 24 septembre 1941) par le général de Gaulle et les F.F.L.
En France, où la situation paraissait bloquée, le nouveau cours de la guerre suscite l'espoir avec la perspective d'un affaiblissement de l'Allemagne. En même temps, il clarifie la situation politique : Vichy s'engage à fond aux côtés de l'Allemagne nazie dans la croisade contre le bolchevisme.
Il en résulte un durcissement du régime, un renforcement de la dictature et l'accentuation de la collaboration. L'image lénifiante et rassurante du Maréchal commence à se désagréger.
Dans ce climat politique nouveau, la Résistance prend de l'audace. L'aspect le plus spectaculaire est la lutte directe contre l'appareil militaire allemand ; actions de harcèlement entamées par les groupes armés du P.C.F. (sabotages, attentats contre les militaires allemands) qui vont constituer les F.T.P.
Parallèlement, se poursuit un lent travail de recrutement et de structuration qui fortifie les organisations de résistance et étend leur influence : émergence de grands mouvements, renforcement des partis politiques clandestins (essentiellement le parti communiste et le parti socialiste), reconstitution d'un mouvement syndical combatif. A Londres, le général de Gaulle crée un Comité National Français (C.N.F.), embryon d'un gouvernement provisoire face à Vichy.
En même temps, entre des forces qui restent dispersées, différentes et même parfois opposées, commencent à se tisser des liens. Ainsi, entre le C.N.F. et certaines organisations de résistance (avec, notamment, l'aide de Jean Moulin) s'établissent des contacts militaires (création de réseaux de renseignement) et politiques.
En France, les convergences fondamentales s'expriment, notamment, dans la célébration du 14 juillet 1942, référence commune à la tradition patriotique et républicaine ancrée dans la Révolution française. L'horreur des grandes rafles de l'été 1942 provoque l'indignation même dans certains milieux attachés à la Révolution nationale (premières protestations publiques d'évêques). Les organisations juives (M.O.I. - O.S.E. - œuvre de secours aux enfants) montent une vaste opération de sauvetage des juifs, en premier lieu des enfants, désormais arrêtés et voués à la déportation. Des connexions multiples s'établissent aussi avec des organisations non juives (notamment en milieu protestant et catholique), en même temps que s'étendent les solidarités individuelles. Ainsi, le combat contre l'antisémitisme est une motivation supplémentaire pour la Résistance et un facteur de sa coordination.
Ces progrès, encore lents et hésitants, mais réels, se heurtent à une répression qui prend dès le début un caractère terroriste. Quasi quotidiennement, sont publiés dans la presse les (Avis) allemands annonçant les condamnations par les tribunaux militaires et les exécutions. Les exécutions d'otages commencent le 6 septembre 1941 et prennent le caractère de massacres collectifs à partir d'octobre 1941.
La déportation des résistants, dans les camps de concentration nazis, est décidée en même temps que s'organise la déportation systématique des juifs. Le gouvernement de Vichy met sur pied des justices d'exception (les sections spéciales contre l'activité communiste ou anarchiste) qui permet d'éliminer tous ceux que Vichy nomme les saboteurs de l'ordre français.
Les forces répressives de Vichy, considérablement renforcées, jouent un rôle essentiel dans la traque des résistants et des juifs ; et, dans les camps d'internement français, l'occupant peut puiser ceux qu'il va fusiller ou déporter. La collaboration entre services français et allemands (ces derniers placés sous l'autorité du S.S. Oberg) est officialisée par les accords (août 1942) entre Oberg et Bousquet (secrétaire général à la Police dans le gouvernement Laval). L'année 1942 est sans doute l'année la plus dure pour la Résistance, dans une situation où le rapport des forces demeure dramatiquement en faveur de l'ennemi. Mais les points marqués par les résistants sont déjà solides.
Photographie de la rencontre à Paris entre Pierre Laval, chef du gouvernement, et le général SS, Carl Oberg, à la tête de toutes les polices allemandes en France depuis avril 1942. Il va perfectionner la collaboration des polices vichystes et allemandes avec René Bousquet, secrétaire général à la police.
La Résistance à l'offensive
1943 – 1944
Le tournant des années 1942-1943 est aussi celui de la guerre, où le rapport des forcesbascule en faveur des Nations Unies. Le débarquement américain en Afrique du Nord (8 novembre 1942) permet aux alliés de prendre pied dans la zone méditerranéenne, en ligne de mire, l'Italie mussolinienne (débarquement en Sicile, et en Italie du Sud, juin-juillet 1943). A l'Est, la Wehrmacht ne se relèvera pas du désastre subi à la bataille de Stalingrad (qui se termine le 2 février 1943).
Ces changements décisifs se répercutent fortement en France. En Afrique du Nord, libérée en mai 1943, peut se reconstituer, surtout avec des levées d'hommes dans l'Empire, une armée française importante. Engagée dans les opérations alliées en Afrique, puis en Italie, elle renforce le poids de la France dans l'issue de la guerre.
En France même, la situation change. Dans une guerre où les destructions s'accumulent, l'Allemagne augmente considérablement ses exigences. Le pillage systématique de toutes les ressources françaises et une répression de plus en plus lourde font monter la haine envers l'occupant.
En même temps, le discrédit du gouvernement de Vichy s'accélère. L'acceptation sans résistance, par Pétain, le 11 novembre 1942, de l'occupation de toute la France, les lois et l'appareil répressif qui fonctionnent pour l'occupant, montrent la satellisation du gouvernement français. Parmi les cadres de l'Etat, certains se désengagent et même passent à la Résistance (notamment des officiers).
Dans le basculement lent et progressif des Français en faveur de la Résistance, le combat contre le pillage de la main d'œuvre joue un rôle essentiel.
La livraison, exigée par l'Allemagne, de centaines de milliers de travailleurs est organisée par le gouvernement de Vichy : les lois du 4 septembre 1942 et du 17 février 1943 imposent le service du travail obligatoire (S.T.0.). La mise en esclavage des hommes au service de l'ennemi provoque indignations et oppositions. Les organisations clandestines se mobilisent pour impulser la désobéissance, sous le mot d'ordre commun pas un homme pour l'Allemagne. Grèves et manifestations s'opposent aux départs ; des complicités sont acquises dans l'administration ; des fichiers sont détruits. Il faut aussi cacher des milliers de réfractaires recherchés par les polices françaises et allemandes. C'est à la solidarité de la population qu'il est fait appel ; pour les aider et les protéger. Ainsi, se tissent entre la population et la résistance organisée des liens qui élargissent la dynamique du combat national. De plus, les réfractaires réfugiés dans les maquis, peuvent, équipés et encadrés par les groupes armés existants, s'intégrer dans la lutte armée.
C'est à ce moment que la Résistance atteint sa maturité. Le 27 mai 1943 est constitué le C.N.R. (Conseil National de la Résistance). Pôle de coordination de l'ensemble des forces de la Résistance, le C.N.R. va dynamiser, à l'échelle nationale, le combat libérateur.
En même temps que les alliés, sur tous les fronts, forcent l'Allemagne à la retraite, la Résistance prend en France une ampleur nationale. Le combat militaire, coordonné en janvier 1944 dans les F.F.I. (Forces Françaises de l'Intérieur) occupe désormais une place de premier plan : guérilla urbaine, petits maquis mobiles pratiquant la guérilla, grands maquis prévus comme môle de résistance (Glières) ; les sabotages dans les transports et l'industrie se généralisent dans les entreprises et prennent des formes spectaculaires (notamment dans les chemins de fer).
Cependant, toutes les autres formes d'action progressent aussi. Le monde ouvrier est en effervescence permanente. Les actions revendicatives et les grèves qui se succèdent et se relaient freinent le pillage, renforcent la combativité et l'organisation (réunification de la C.G.T.). Dans la population, on constate l'élargissement de la désobéissance aux autorités et, en même temps, le développement des solidarités, avec la multiplication des gestes individuels d'aide et de protection envers les résistants. L'ampleur et les aspects nouveaux des manifestations traduisent l'élévation de la combativité et la force retrouvée du sentiment national.
L'occupant entreprend, avec fureur, de disloquer ce front intérieur. Aux forces allemandes, toutes mobilisées- y compris la Wehrmacht - s'ajoutent les polices de Vichy désormais aux mains des éléments fascistes et ultra collaborateurs (la Milice). A la répression ordinaire exécutions et déportations s'ajoutent les tortures systématiques dans les prisons, les exécutions sur place des résistants arrêtés. Fait nouveau, se développe une terreur de masse qui frappe la population : exécutions et destructions de villages dont Oradour sera l'exemple le plus célèbre.
Mais l'ennemi ne parviendra pas à stopper la montée de la Résistance qui pourra jouer tout son rôle dans la libération de la France.
Coordonner
la Résistance
La Résistance est plurielle. Chaque organisation a ses caractéristiques propres ; les conceptions du combat, les visions de la France libérée y sont différentes, parfois opposées. Cependant, sous des formes diverses, leurs actions ont comme objectif la reconquête de l'indépendance nationale. Ce fil conducteur commun se révèle de plus en plus dans la presse clandestine et les émissions françaises de la B.B.C., ainsi que dans certaines actions patriotiques (ainsi les 14 juillet).
Le processus de rapprochement s'accélère en 1943. L'oppression et l'exploitation du pays par l'occupant atteignent un degré insupportable, dont le S.T.O. donne la mesure, au moment où le gouvernement de Vichy s'enfonce totalement dans la collaboration. A cette véritable destruction de la nation française, la Résistance doit faire face. Elle doit devenir une force offensive d'ampleur nationale.
Il faudra des mois pour que réticences et oppositions soient surmontées au cours de multiples (et dangereux) contacts où Jean Moulin joue un rôle essentiel. La réunion du C.N.R., le 27 mai 1943, sous la présidence de Jean Moulin, traduit la réussite de l'opération. Les 16 représentants des principales organisations clandestines ont mission de diriger la lutte du peuple français sur son propre sol, en liaison avec le C.N.F. que préside le général de Gaulle (dont Jean Moulin est le délégué).
Enfin, dans son programme d'actions de la Résistance, adopté à l'unanimité, le 15 mars 1944, le C.N.R. définit les conditions d'une véritable libération nationale. Son programme d'action immédiate appelle à l'engagement massif des Français dans un combat immédiat, incessant, et multiforme. Les mesures à appliquer pour la libération du territoire dessinent, dans les domaines politiques, sociaux, économiques, les traits d'une République nouvelle, profondément démocratisée.
Témoignages
Jean Moulin
Le mérite de la création du CNR revient sans aucun doute à Jean Moulin qui, lorsqu'il se rendit à Londres et rencontra le général de Gaulle, proposa à ce dernier de lui confier la tâche de rassembler en son nom toutes les forces de la Résistance. De Gaulle qui était très loin de partager les idées politiques de Jean Moulin accepta néanmoins, car cet homme lui inspirait de l'admiration par sa détermination à vouloir se battre jusqu'à la victoire. Jean Moulin sut obtenir les moyens nécessaires à la réussite de son entreprise. Jean Moulin repartit en France dûment mandaté et chercha ses collaborateurs parmi ceux qui travaillaient avec lui alors qu'il était chef de cabinet du ministre radical Pierre Cot, lors du Front Populaire en 1936. C'est ainsi que Frédéric-Henri Manhès, Robert Chambeiron et moi-même furent contactés par Jean Moulin, fidèles à notre pensée politique, nous nous sommes unis au service de la Résistance.
Première réunion : 27 mai 1943
Le Conseil se réunit en séance plénière le 27 mai 1943, chez un ami de mon frère, M. R. Corbin, 48 rues du Four. Seuls connaissaient l'adresse Moulin et les secrétaires. Des rendez-vous furent donnés en divers points de Paris, les uns devant informer les autres. Ils se rencontrèrent donc par groupes de deux ou trois et s'acheminèrent vers le lieu connu de l'un d'eux. C'est Meunier et Chambeiron qui avaient organisé ces rencontres. Ces précautions étaient indispensables pour qu'il n'y ait pas de fuites. Aussi les divers membres arrivèrent à peu de minutes de distance et se rencontrèrent au premier étage, dans la salle à manger de M. Corbin. Pierre Meunier m'a dit qu'il avait su après coup que le concierge de l'immeuble ou de celui d'en face était un agent de la Gestapo. Le danger, pour les Résistants, était à chaque coin de rue. Heureusement, ce jour-là, rien ne fut éventé.
La coordination
Septembre 1943. C'est à l'âge de trois ans que la Résistance a atteint sa majorité. Cette date a été marquée par l'autorité prise par le Conseil national de la Résistance et les comités qui en dépendent. Tout ce qui avait été fait par chacun servait dorénavant à tous, que ce soit sur le plan de l'organisation pure, sur le plan de l'action ou sur le plan des doctrines et de la politique. Cela ne suffisait pas, certes, à mettre tout le monde d'accord et à permettre à chacun de parler au nom de tous. Mais cela permettait déjà de dégager sur beaucoup de points une majorité devant laquelle chacun devait s'incliner. Cela permettait de faire un tout d'efforts qui, précisément parce qu'ils avaient été ou peu épars, portaient chacun la marque, plutôt que d'une tendance, d'une préoccupation dominante qui, d'ailleurs, provenait souvent de recrutements différents donnant à chaque groupe des possibilités différentes. Enfin, cela permettait de ne plus diviser les résistants de même origine que des occasions particulières avaient conduits à adhérer à des groupes distincts, en même temps que cela réunissait des résistants d'origine diverse. Et l'on ne saurait dire lequel des deux était le plus important.
Maxime Blocq-Mascart, Chroniques de la Résistance, Paris, 1945.
L'organisation
Vaille que vaille, une organisation un peu bâtarde fut mise sur pied. Un bureau permanent fut institué ; il comprenait, autour du président, Pierre Villon pour le Front National, Saillant pour la C.G.T. (alors de tendance socialiste), Pascal Copeau pour Libération, et enfin Blocq-Mascart soudain revenu de ses sentiments d'hostilité ! Le Conseil fut divisé en quelque sorte en cinq sections de trois membres, les membres du bureau permanent jouant le rôle de président et de porte-parole de deux délégués qui ne participaient pas au bureau permanent. Les désignations se firent par affinités. A l'époque je regrettais la rareté des séances plénières du C.N.R. et la méthode qui allait se développer d'échanges de notes. J'en conviens aujourd'hui qu'elle assure un maximum de sécurité : des seize membres fondateurs seuls Simon (O.C.M.), Coquoin (C.D.L.L.), Claude Bourdet (Combat) tombèrent dans les filets de la Gestapo, mon ami Claude étant heureusement sorti vivant de l'épreuve des camps. Le secrétariat de Bidault, porteur de nos papiers, connut une seule chute. Le manque de contacts directs entre les seize n'était pas sans inconvénients, il figeait les positions, il prolongeait longuement les discussions entre sections, occasionnant une considérable perte de temps. Il laissait enfin au bureau une autonomie que certains jugèrent excessive. Entre deux maux, j'estime aujourd'hui que nous avons choisi le moins mauvais. Cette procédure à plusieurs degrés n'empêcha pas le C.N.R. de faire du bon travail.
À l'appel du C.N.R. 11 novembre 1943 à Digoin.
En 1943, nous étions trois communistes dans une petite usine de céramique à Digoin, dans la Saône-et-Loire. Trois communistes militants, mais pas mal de sympathisants. Les ouvriers avaient gardé le souvenir des luttes et des grèves de 1936. Le 11 novembre, nous avons lancé, nous les communistes, le mot d'ordre d'une manifestation à l'intérieur de l'usine et d'une grève d'une heure et demie, de 10 heures à 11 h 30. On a défilé dans la cour de l'usine en criant (1918 -1918). Un camp du génie était juste à côté. Seule la ligne de chemin de fer Moulins-Paray nous en séparait. Les Allemands étaient sur le château d'eau du camp et nous défilions face à eux. Ils n'eurent pas de réaction. Même les employés de l'usine avaient quitté leurs bureaux pour assister au défilé. Cette manifestation eut beaucoup d'écho dans la ville. Très vite, dans l'usine, se constitua un syndicat et, le 30 novembre, un cahier de revendications était déposé sur le bureau du directeur. Il en devint aussi pâle que les éviers qu'on lui fabriquait.
Il nous a dit : C'est très bien, je vous ferai appeler pour vous donner ma réponse.
À l'appel du C.N.R. 11 novembre 1943 à Renault Billancourt
A cette époque, je travaillais aux usines Renault à Billancourt, place Nationale, en qualité de tourneur professionnel, après y avoir été apprenti. Vers la fin octobre 1943, je me suis mis en liaison avec le Parti par l'intermédiaire d'un camarade. Dans mon secteur, je syndique une douzaine de personnes. Dans d'autres ateliers, des copains, en liaison avec moi, travaillent de même. Divers tracts clandestins nous sont remis et distribués dans l'usine, entre autres le Métallo, la Vie ouvrière, Résistance ouvrière. Le 11 novembre 1943, sans préliminaire, grève générale d'une heure chez Renault. Dans mon secteur, avec un camarade, nous faisons débrayer notre atelier, et contribuons à en faire débrayer d'autres. Ce fut une réussite. Nous avons déployé un drapeau tricolore sur la façade principale. Il y est resté toute la journée.
Les manifestations
La Résistance qui s'ébauche dans les premiers mois de d'Occupation s'efforce de trouver des formes d'actions adaptées à la pauvreté des moyens dont elle dispose. Manifester est une façon de montrer son refus de l'occupation et de la collaboration, d'affirmer son attachement aux valeurs patriotiques et républicaines.
La première grande manifestation en zone nord se déroule à Paris le 11 novembre 1940. Depuis juillet, les étudiants et les lycéens multiplient les actions ponctuelles contre la politique d'épuration du corps enseignant et de l'enseignement entreprise par Vichy et par l'Occupant. L'interdiction de toute célébration le 11 novembre 1940 est l'élément déclencheur : des milliers de jeunes convergent vers la place de l'Etoile. La répression est sévère.
Ce même jour, plusieurs puits de mine du Nord-Pas-de-Calais sont en grève. En effet, le bassin minier est un autre espace de revendication. Avant même la grande grève des mineurs de mai-juin 1941, de multiples arrêts de travail et des manifestations de femmes révèlent la mobilisation populaire contre la politique de collaboration économique avec l'Occupant. Bien que suscitées par des organisations de mieux en mieux structurées, dotées de publications et de capacités de diffusion de plus en plus perfectionnées, les manifestations des années d'Occupation témoignent constamment d'un engagement qui dépasse largement les seuls résistants. Malgré les risques encourus (la répression est rigoureuse dès les premiers mois et se durcit considérablement par la suite), les participants sont nombreux.
En zone sud, le 14 juillet, férié mais interdit de célébration, demeure une date de commémoration républicaine et patriotique grâce à l'organisation de manifestations sans rassemblement et silencieuses. En zone nord, des drapeaux tricolores sont apposés sur les bâtiments publics et les monuments aux morts. La mobilisation est importante, particulièrement en 1942 et 1943. Le CNR démontre son influence en appelant à manifester le 11 novembre 1943 : le mouvement est d'ampleur nationale et s'accompagne de nombreuses grèves. Durant toute la guerre, le 1er mai reste l'occasion de montrer son attachement à la fête des travailleurs et au mouvement social, malgré la volonté du régime de Vichy de lui substituer la Saint-Philippe, illustration du culte du Maréchal.
Les protestations peuvent se développer en dehors de ces dates symboles, en réaction aux décisions de l'Occupant allemand ou de l'Etat français. Dès 1940, des prises de paroles tentent de sensibiliser la population. En 1941, des manifestations de femmes sont organisées dans la banlieue parisienne pour demander la libération des prisonniers de guerre. En 1942, des étudiants parisiens arborent une étoile de David fantaisiste pour dénoncer les mesures antisémites (ce qui leur vaut un internement de trois mois à Drancy). En 1943, des rassemblements tentent de bloquer les trains du STO en partance pour l'Allemagne (comme à Montluçon et à Romans). En mai 1944, des femmes de Marseille manifestent pour plus de pain et contribuent au déclenchement d'une grève générale.
Toutes les occasions de montrer son désaccord sont exploitées : des sifflets accompagnent la diffusion des actualités cinématographiques pro-allemande, les affiches de l'Occupant ou de l'Etat français sont systématiquement détériorées, le public assiste en nombre aux enterrements des résistants fusillés ou des aviateurs alliés abattus, etc.
Ces démonstrations populaires, collectives ou individuelles, revendiquées ou anonymes, répondent à la propagande nazie ou collaborationniste qui veut faire croire à l'adhésion massive de la population française. Elles soulignent que la population n'est plus dupe : au cours des années, elle est passée d'un attentisme prudent à une passivité bienveillante puis, à partir de 1943, à une complicité de plus en plus active. Cette évolution explique la participation générale au soulèvement national de l'été 1944, stimulée par les multiples appels à la mobilisation et facilitée par la déliquescence des forces de répression, encore capables cependant des pires exactions. La ferveur des défilés de la Libération n'en sera que plus intense.
Première arme de la Résistance
LA PRESSE CLANDESTINE
Première arme de la Résistance
L'occupant et l’État français détiennent le monopole de la parole. Faire entendre une, parole différente est donc, une condition pour développer l'esprit de résistance et organiser la lutte du peuple français pour sa libération.
Seule capable matériellement de toucher l'ensemble de la population française, la radio peut combattre l'ennemi à armes presque égales. Dès la mi-juillet 1940, quotidiennement, on peut entendre à la BBC deux émissions françaises, Honneur et Patrie et Les Français parlent aux Français.
Le poids de la presse clandestine est d'un autre ordre. Elaborée sur le terrain, expression directe de la variété des situations et de la diversité des opinions, elle dénonce, elle argumente en temps réel au plus près des problèmes de la population. Signe visible de la Résistance, la parole clandestine mobilise et recrute chaque jour de nouveaux combattants. Nombre des Mouvements de résistance des plus importants naissent autour d'un journal clandestin, tels défense de la France ou Combat.
La masse et la variété de la presse clandestine sont une des originalités de la Résistance française : plus de 1200 titres de journaux clandestins tirés à près de 100 millions d'exemplaires pendant les 4 ans d'occupation ; sans compter les centaines de milliers de tracts, de papillons, de brochures, d'affichettes ou les inscriptions murales.
Pour autant, la parution d'une feuille clandestine se heurte à des difficultés matérielles considérables. Les matériaux et les machines nécessaires à la fabrication sont rares et contingentés ; leur vente est étroitement surveillée par la police. Ceux-ci en outre doivent être camouflés dans des planques sûres. Les premiers procédés d'édition sont très simples : souvent le texte est écrit à la main, tapé à la machine ou polycopié en quelques exemplaires qu'on fait circuler. Cependant deux procédés sont particulièrement utilisés dans la production clandestine. L'imprimerie ronéo : de petites dimensions, ces machines s'installent sur une table et fonctionnent à la main. Le tirage peut atteindre les 700 à 800 exemplaires à l'heure. L'imprimerie typographique : seule celle-ci est capable d'effectuer les tirages de masse.
Quel que soit le procédé de fabrication employé, il faut donc du courage, de la ténacité, de l'ingéniosité, mais aussi l'établissement de tout un réseau de complicités, s'étendant au - delà du groupement clandestin publiant le journal.
L'importance de la répression est à la mesure du rôle essentiel de la parole clandestine. Les pertes subies, par ceux qui font vivre la presse clandestine pendant 4 ans, sont très lourdes, impossibles à chiffrer : combien de dactylos, de tireurs à la ronéo, de transporteurs, de distributeurs. Les travailleurs de l'imprimerie, maîtres et ouvriers, sont très durement touchés. Sur 1200 travailleurs du livre résistants, 400 ont été tués, exécutés ou déportés.
A la Libération, sortis de la clandestinité, un nouveau journalisme et une nouvelle presse contribuent de manière importante à un renouveau démocratique dans le pays.
L'armée des ombres
LA CLANDESTINITÉ
L'armée des ombres
Sauter le pas pour entrer dans l'action résistante est la première difficulté. Ce peut être une rupture avec son propre milieu : le cas du général de Gaulle est, ici, exemplaire. Et puis, il n'est pas toujours facile de trouver le contact avec un groupe organisé. La plupart des résistants engagés dans l'action clandestine continuent à vivre et à travailler dans leur cadre habituel. Certains particulièrement recherchés, doivent devenir des clandestins complets, des illégaux.
Pour tous les résistants c'est l'ensemble de leur vie qui est bouleversée, en premier lieu, la vie de couple. Certes mari et femme - parfois enfants - travaillent de concert. Mais les choses se compliquent quand l'un des deux seulement est engagé ; les règles de prudence exigent la discrétion et peuvent mettre en cause la confiance mutuelle. Plus dure encore la séparation nécessaire pour le résistant ou la résistante qui doit devenir totalement clandestin, quitter son domicile, couper avec les siens. Dans la société française d'alors, le cas des femmes est particulièrement dramatique : le combat que la mère assume pour assurer l'avenir de ses enfants exige, dans l'immédiat, qu'elle les prive de sa présence, de son aide, de son affection ; et qu'elle se prive elle-même de la joie de les voir vivre et grandir.
Pour le clandestin, isolé de ses proches, privé de ses ressources habituelles, couvrir ses besoins les plus élémentaires pose des problèmes aigus.
Il lui faut trouver une planque, vivre sous une fausse identité et la carte d'identité est exigée à toute heure et en tout lieu. Impossible de se ravitailler sans cartes d'alimentation et sans inscriptions chez les commerçants, de se vêtir sans cartes spéciales, de se soigner sans risquer d'être découvert. À partir de 1942, avec le développement de la réquisition de la main-d'œuvre, sont exigées des cartes de travail.
La vie du clandestin dépend donc de l'aide des organisations de résistance. L'organisation de cette intendance sera pour la Résistance l'un des secteurs vitaux et décisifs de son action. Elle s'appuie de plus en plus sur les actes de solidarité de la population.
Illégaux ou légaux, les résistants, en s'intégrant dans un combat clandestin, entrent dans une vie où la menace de l'arrestation, de l'interrogatoire, de la torture, de l'emprisonnement et de la mort est suspendue sur eux. Ils sont en infraction permanente avec la loi : objets interdits (matériel d'impression, feuilles clandestines, postes émetteurs, faux papiers, armes, etc.) qui sont entreposés chez eux ou qu'ils doivent transporter ; un contrôle, une fouille, une perquisition, et c'est la chute. Tout déplacement peut être l'occasion d'une filature de police. Tout rendez-vous avec un autre résistant peut devenir une embuscade. Pourtant ces contacts réguliers assurés par des agents de liaison souvent des femmes sont indispensables au fonctionnement de l'organisation. Des consignes strictes et minutieuses de vigilance sont mises au point. Leur application est loin d'être facile d'autant que dans certaines circonstances, la Résistance doit se découvrir : prise de parole, manifestations, distribution de presse, grève, actions armées contre les forces de l'occupant ou de l'État Français.
Ami entends-tu.
LUTTE ARMÉE
Si la Résistance est née partout, tout de suite, sur le territoire français, la lutte armée a mis du temps à prendre une forme organisée et efficace. Dès l'été 1940, quelques attentats sont commis contre les troupes allemandes, durement réprimés mais, durant cette période, ceux qui refusent la défaite, l'occupation ou la collaboration qui s'amorce préparent l'avenir en cachant les armes des militaires (en les ramassant et en soustrayant aux commissions de surveillance des clauses de l'armistice) et des civils (en cachant les armes de chasse réclamées et en ne livrant aux autorités que de vieilles pétoires).
Les premiers réseaux mis en place par les Britanniques et la France libre donnent la priorité à la recherche et la transmission de renseignements militaires. Les premiers mouvements s'organisent plutôt autour de la publication de journaux. Rapidement, la volonté d'attaquer directement les troupes allemandes et les forces qui collaborent avec elles s’imposent mais bute sur la difficulté à s'organiser, à trouver des soutiens et des armes dans un contexte de résignation et de désorientation.
Les communistes sont les premiers à se lancer dans l'action directe et systématique. En août 1941, Fabien tue un officier allemand dans le métro à Paris. D'autres attentats suivent qui entraînent la réplique violente et terrible des exécutions d'otages. La lutte armée n'est pas l'apanage des communistes, les noms des autres mouvements révélant leur volonté de passer à l'action directe (Franc-tireur, Combat, Vengeance, Valmy, etc.). En zone sud, l'Armée secrète est mise en place courant 1942, mais elle n'entre en action qu'à la fin de l'année. Les FTP du Front national assurent l'essentiel de l'effort pendant de très longs mois, prenant ses armes à l'ennemi pour continuer la lutte.
A la fin 1942 et au début 1943, des corps francs armés plus actifs se développent. Ils trouvent leur équipement au gré des circonstances et, de plus en plus, grâce aux parachutages organisés avec la complicité des agents de la France libre et du SOE britannique. L'instauration du STO en février 1943, donc l'obligation pour les jeunes hommes d'aller travailler en Allemagne, conduit nombre de réfractaires à chercher refuge dans les premiers maquis vite grossis par cette arrivée massive de rebelles le plus souvent inexpérimentés, qu'il faudra former et armer. En 1943-1944, les organisations armées se multiplient, la plupart menant une existence totalement clandestine, dans les zones rurales isolées comme dans les grandes métropoles. La guérilla urbaine, souvent prise en charge par des bataillons d'étrangers (comme les FTP de la MOI) afflige des pertes importantes à l'occupant et aux collaborateurs. Les maquis entretiennent des zones d'insécurité avec le soutien des habitants qui leur fournissent le ravitaillement.
Les FFI parviennent cependant à libérer seuls le sud-ouest de la France et le Massif central. Ailleurs, ils apportent une aide précieuse aux troupes alliées. Le symbole de la Résistance en arme reste la libération de Paris : le 17 août, à l'appel du CPL, la grève générale se transforme en insurrection que l'arrivée des chars de Leclerc parachève le 25 août avec la capitulation des troupes allemandes.
Les FFI, souvent jeunes et mal armés, parfois mobilisés de la dernière heure, seront incorporés dans l'armée régulière de la France combattante et poursuivront jusqu'en Allemagne la lutte armée.
Reconstruire une armée française
Forces françaises libres
La Résistance extérieure naît le 18 juin 1940 avec l'appel du général de Gaulle, répondant au discours du maréchal Pétain de la veille en refusant l'armistice et en continuant la résistance militaire. De Gaulle est seul, même si le 28 juin le gouvernement britannique le reconnaît officiellement comme chef de tous les Français libres.
Les ralliements à de Gaulle sont d'abord limités. La plupart des militaires français réfugiés en Grande-Bretagne préfèrent l'Etat français né de la défaite à une France combattante siégeant à Londres. Les rares soutiens viennent de l'Empire. Des officiers (comme Leclerc) et des administrateurs (comme Eboué) conduisent l'Afrique occidentale dans le camp de la France libre dès août 1940 atténuant l'échec du débarquement à Dakar en septembre 1940. En 1941, la Nouvelle Calédonie, Tahiti, les possessions en Inde se rallient à leur tour, permettant à de Gaulle d'asseoir sa légitimité auprès des Alliés britanniques, puis américains et soviétiques. En décembre 1941, la France libre a une représentation diplomatique à Londres et à Moscou.
Les Forces françaises libres sont modestes. En 1941, elles regroupent les troupes de Leclerc au Tchad (qui s'illustrent à Koufra), quelques marins et quelques aviateurs en Grande-Bretagne et au Moyen Orient (après les opérations de Syrie). En juin 1942, la brigade de Koenig se distingue à Bir Hakeim. Ces forces s'étoffent après le débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942. L'armée française issue de l'armistice hésite un moment entre l'obéissance au général Giraud, soutenu par les Américains et peu enclin à dénoncer le régime de Vichy, et le ralliement au général de Gaulle. Finalement, avec le soutien déterminant de la Résistance intérieure, c'est la seconde option qui l'emporte, permettant à de Gaulle d'écarter Giraud et de rester le seul interlocuteur des Alliés.
Dès 1943, les Forces françaises libres, équipées par les Américains, se battent avec les Alliés. Un effort de mobilisation permet de constituer une armée de 500 000 hommes, en grande partie constituée d'Algériens et de Marocains, sous le commandement de chefs ayant rompu avec Vichy (de Lattre de Tassigny, Juin). Cette armée est engagée en Italie à partir de 1943 puis en France en 1944 : la division Leclerc débarque en Normandie et l'armée dirigée par de Lattre débarque en Provence, la première participant à la libération de Paris, la seconde remontant au travers du sud-est du pays, délivrant Marseille et Lyon avec l'appui de la Résistance intérieure qui a déclenché l'insurrection nationale.
Au fur et à mesure de la libération du territoire français, les Forces françaises de l'Intérieur sont versées dans l'armée régulière pour accroître la place de la France au sein des armées alliées. En décembre 1944, Strasbourg est libéré, concrétisant le serment de Koufra de 1941. Les troupes françaises entrent au début 1945 en Allemagne, occupant le sud ouest du pays. Les 7 et 8 mai 1945, le général De Lattre peut signer l'acte de capitulation sans condition de l'Allemagne au nom de la France (à Reims puis à Berlin), car son armée, issue des FFL et des FFI ayant refusé l'armistice de 1940, a participé à la victoire finale aux côtés des Alliés. Le général Leclerc tient le même rôle le 2 septembre 1945 lors de la capitulation du Japon.
Défendre la culture
PENSÉE LIBRE
Le contenu de la culture nouvelle qu'il faut promouvoir est parfaitement exprimé dans le discours de Rosenberg, prononcé le 28 novembre 1940 à Paris, et largement publié sous le titre Sang et Or, Règlement de comptes avec les idées de 1789. Le nazisme, dans sa doctrine et sa pratique, est en effet l'antithèse des acquis de laGrande Révolution : le Führer à la place de la citoyenneté ; le racisme et l'exclusion à la place de l'égalité ; le totalitarisme à la place de la liberté ; la mystique à la place du rationalisme. La Révolution nationale, sur bien des points, va dans ce sens.
Pour mettre au pas les Français afin d'atteindre les objectifs immédiats et lointains assignés à l'occupation, la répression ne suffit pas. Il faut désarmer en profondeur les résistances en rendant acceptable, voire même enviable, le national-socialisme. L'occupant met en place immédiatement un vaste dispositif chargé de distiller dans l'opinion les mérites du nazisme, et d'orienter toute la vie culturelle française : la cheville ouvrière en est l'ambassade d'Allemagne à Paris (Abetz). "L'Institut allemand" nourrit revues, expositions, rencontres, échanges, etc. Le mouvement Collaboration, que préside Alphonse de Châteaubriant, directeur du journal la Gerbe, multiplie les groupes réunissant surtout les notables.
La première riposte à cette opération de rééducation est donnée par le philosophe communiste, Georges Politzer, dans une brochure clandestine publiée en 1941 (Révolution et Contre-révolution au 20ème siècle, Réponse à Or et Sang de M. Rosenberg). La dénonciation des entreprises visant à briser la culture, la critique systématique du nazisme et du vichyste seront particulièrement développées dans certaines publications clandestines. Les unes s'inscrivent dans les combats antifascistes des années 1930 : l'Université Libre (1er numéro, novembre 1940) fondée par Georges Politzer ; Les Lettres Françaises fondées par Jacques Décours (1er numéro, 1942).
Dans cette bataille idéologique, les organisations clandestines juives, notamment celle de la M.O.I., ont un rôle constant. Elles dénoncent le soi-disant caractère scientifique du racisme et l'utilisation de l'antisémitisme comme moyen d'intoxication et de division des peuples par leurs oppresseurs (Brochure de Gronowski L'antisémitisme, le racisme, le problème juif, novembre 1941).
D'autres naissent dans certains milieux chrétiens qui, avant-guerre, avaient déjà alerté sur le caractère profondément anti-chrétien du nazisme ; ainsi naissent dans la région lyonnaise, en novembre 1941, les Cahiers du Témoignage Chrétien.
Dans la nuit des prisons
CAMPS ET PRISONS
Dès leur entrée en France, les Allemands emprisonnent tous ceux qui d'une manière ou d'une autre s'opposent à leur progression puis à leur présence. L'Etat français après l'armistice multiplie les internements, ajoutant ses propres prisonniers à ceux enfermés par la Troisième République (allemands antifascistes ou dirigeants communistes par exemple). Près de 900 lieux de détention permanents ou provisoires (camps d'internement, prisons, centrales, forteresses, camps de transit, etc.), gérés le plus souvent par l'administration pénitentiaire française, sont utilisés en France (zone nord et zone sud) et en Algérie. Poussant au plus loin la logique de la collaboration, l'Etat français n'hésite pas à livrer ses prisonniers aux Allemands (détenus politiques livrés comme otages à fusiller, internés juifs voués à la déportation vers l'Est).
Au sein des Mouvements ou des institutions religieuses et caritatives, des structures de solidarité sont créées. Les organisations juives s'efforcent de sauver les enfants, avant les rafles (avec l'aide de non-juifs) et dans les camps d'internement, particulièrement dans le sud de la France. Les familles et les amis des résistants arrêtés refusent d'abandonner leurs proches et s'efforcent de leur fournir du ravitaillement, des vêtements propres et des nouvelles, les avocats jouant dans ce domaine un rôle non négligeable. Les complicités intérieures facilitent les contacts : les autorités allemandes se méfient de plus en plus de l'attitude des gardiens français.
Les détenus eux-mêmes tentent de faire front. La reconnaissance du statut de prisonniers politiques permet d'améliorer la situation des résistants internés en les distinguant des prisonniers de droit commun : le respect des gardiens et les responsabilités administratives confiées à certains détenus améliorent le sort de tous et aident à l'organisation clandestine. Partout, la solidarité est une manière de ne pas abdiquer face à l'oppression : le partage d'un colis, les plaies pansées après la torture, un regard échangé pour rompre l'isolement entretiennent l'espoir.
Dans un grand nombre de prisons et de camps, les informations circulent sous forme de feuillets manuscrits plus ou moins élaborés. Une vie intellectuelle se maintient derrière les barreaux, rendue plus intense par l'engagement de ceux qui savent que la mort est au bout du chemin : les récitations de poèmes, les cours improvisés, les représentations théâtrales parfois, font oublier un court instant que le combat pour la vie est toujours plus difficile.
Les déportés des camps de concentration tenteront, dans des conditions plus épouvantables encore, de maintenir cet esprit de résistance, rendu presque impossible avec l'épuisement par le travail, la faim permanente et la déchéance physique et morale.
Quand les circonstances le permettent, des évasions sont tentées. Les transferts offrent des opportunités, mais des détenus parviennent à s'échapper depuis les prisons ou les camps mêmes, les complicités extérieures étant déterminantes dans la plupart des cas.
La liberté n'est cependant pas au bout du chemin pour des dizaines de milliers de prisonniers. Les exécutions et les déportations déciment régulièrement la population des camps et des prisons. La Marseillaise qui retentit alors derrière les portes des cellules et des baraquements est un ultime encouragement à ceux qui vont mourir ou disparaître dans la nuit et le brouillard.
Pour le pain et la liberté
LUTTES SOCIALES
En août 1944, les employés de l'usine Genève à Ivry, qui ont réalisé des dizaines d'arrêt de travail sous l'occupation, se rassemblent pour préparer l'insurrection. L'issue paraît assez proche pour qu'on puisse se laisser photographier. C'est un des militants les plus actifs, Truquet, qui tient l’appareil et à qui nous devons ce document exceptionnel.
Le front intérieur qui se construit en France comme dans l'ensemble des pays occupés n'a rien à voir avec les fronts d'une guerre classique. Dès le début, le terrain des luttes sociales est primordial dans le combat national. Toute action revendicative - débrayage, ralentissement des cadences, grève perlée ou ouverte - affaiblit la production au profit de l'Allemagne, freine la dégradation des conditions de vie des travailleurs, et ébranle la résignation. Dès l'été 1940, et durant les 4 années d'occupation, dans les deux zones, les exemples sont innombrables. Cependant par l'ampleur du nombre de grévistes (100 000), la durée (1 mois), les pertes économiques subies par l'occupant (500 000 tonnes de charbon), la grève des mineurs des bassins du Nord et du Pas-de-Calais en mai - juin 1941 demeure exemplaire. Toute action populaire contre le chômage, contre la vie chère, les difficultés de ravitaillement - pétitions, manifestations - fait obstacle au pillage allemand en même temps qu'elle protège la vie des Français. Dans ces initiatives, la mobilisation des femmes est importante et prend de plus en plus un caractère de masse. Ainsi, en mai 1944, à Marseille, les femmes déclenchent des actions revendicatives qui se transforment en un mouvement insurrectionnel. En relation avec le Service du travail obligatoire (STO) se développent des refus concertés. Les manifestations à Montluçon ou à Romans qui permettent la fuite des travailleurs requis en empêchant le départ des convois pour l'Allemagne ne sont ni uniques, ni isolées. Les traditions de lutte et d'organisation de la classe ouvrière constituent la base d'une véritable résistance ouvrière.
Dans les deux zones, cette résistance est animée essentiellement par le Parti communiste et des Comités populaires qu'il impulse, et par des syndicalistes cégétistes, tel Christian Pineau, qui refuse la politique antisyndicale du gouvernement de Vichy. Les syndicats se reconstituent clandestinement, particulièrement par la CGT réunifiée en 1943. En zone sud, des Mouvements développent aussi l'action dans les entreprises: Libération avec le Mouvement ouvrier français (MOF), Combat avec l'Action ouvrière. A la campagne, le pillage de l'occupant et le carcan bureaucratique et étatique de l'Etat Français réactivent les traditions ancestrales des luttes paysannes: refus des réquisitions des récoltes et du bétail, de l'alourdissement de l'imposition, du dirigisme des corporations. Cette résistance s'intègre à la Résistance en général, notamment par l'aide aux maquis et aux réfractaires au STO.
Ces mouvements revendicatifs apparaissent au premier plan dans les préoccupations de l'occupant et du gouvernement de Vichy. La répression où collabore souvent patronat et police est systématique et sans cesse aggravée, même si parfois des concessions sont jugées nécessaires pour éviter le pire. Cette inquiétude n'est pas vaine. Coups d'épingles multipliés ou actions plus audacieuses, ces luttes obstinées affaiblissent en permanence le potentiel économique de l'Allemagne, conjuguant leurs effets à ceux des sabotages et à ceux des bombardements.
En outre, elles enracinent en milieu populaire un esprit de refus et de combativité qui isole de plus en plus l'occupant et l'État Français, et qui constitue un tremplin pour l'essor général de la Résistance. La CGT et la CFTC sont d'ailleurs membres fondateurs du Conseil national de la Résistance (CNR).
Libérer la France
LA LIBÉRATION
Il s'agit d'abord d'affaiblir les forces ennemies pour gêner leurs contre-offensives : sabotages des communications (la bataille du rail) ; harcèlement et division des armées allemandes par la guérilla et les opérations des maquis. Sur le front même, les groupes de résistance fournissent renseignements et guides. En amont, ils nettoyant le terrain, permettant aux armées des avancées spectaculaires : ainsi, en Bretagne (libérée en 5 jours) et dans le Sud-Est, où l'armée du général De Lattre est littéralement aspirée dans la vallée du Rhône par la Résistance. Celle-ci, d'ailleurs, va libérer seule près de la moitié de la France dans le Centre et le Sud-Ouest.
Mais cette bataille de la France n'est pas livrée par les seuls militaires. L'intervention massive des civils donne à l'action l'allure d'un soulèvement national : manifestations patriotiques bravant les ennemis et confirmant la mobilisation populaire qui porte en avant la Résistance (14 juillet 1944) ; mouvements de grèves s'épanouissant en grève générale et paralysant l'appareil économique de l'ennemi ; la population peut aussi s'agréger à la lutte armée (sabotages, coup de main, barricades). Paris offre l'exemple le plus remarquable de ce processus conduisant à l'insurrection libératrice.
La participation du peuple français à sa propre libération n'a pas seulement contribué à accélérer la défaite allemande. Elle a permis d'installer en France, à la place de Vichy, le personnel et les institutions républicains préparés auparavant.
MANIFESTATION DU 11 NOVEMBRE 1940
Paris, automne 1940. La France est vaincue. Philippe Pétain rencontre Hitler à Montoire. La défaite prend un visage, celui d'un Paris occupé où déambule l'occupant, et où les panneaux de signalisation des grands lieux de la capitale sont rédigés en allemand. L'ennemi est là. Ce n'est plus celui des communiqués officiels de la drôle de guerre, ni celui d'une propagande abstraite. Il est présent physiquement même s'il se veut discret et Korrect. Son dispositif d'oppression et de pillage se met en place avec la complicité de Vichy : censure, interdiction, saisies, installation d'un institut allemand qui donne la ligne ; épuration raciale et politique à l'initiative de l'État français ; attaques de la République, mise en cause de ses valeurs par les idéologues du nazisme et de la Révolution Nationale. Que faire ? Le choc de l'exode et de la défaite imprègne les esprits, le nazisme semble triompher partout. C'est dans ce cadre que se situe la première grande action de Résistance. Quelles en sont les origines, le déroulement, les conséquences?
Des gestes individuels, des regroupements manifestent une variété de réactions : certains strictement nationalistes et/ou patriotiques (refus de l'occupant et de considérer la défaite comme définitive) ; d'autres intègrent la dimension républicaine et antifasciste (dénonciation des idéologies nazies et de la Révolution Nationale, de la perte des libertés, de la répression.). Un vent de fronde souffle au quartier Latin et dans les lycées. Depuis la réouverture de la Sorbonne, lancers d'œufs pourris, inscriptions, papillons et tracts laissés dans les livres ou les fichiers (des bibliothèques), manifestations de petits groupes exhibant fièrement deux cannes à pêche (de Gaulle), des bagarres dans les cafés, lancer de tracts par des jeunes communistes le 31 juillet dans le grand amphithéâtre ; répondent à la présence allemande jusque dans l'université, et dénoncent la propagande de Vichy contre l'esprit critique et scientifique, l'humanisme et la laïcité. L'enseignement de professeurs à l'encontre des nouveaux dogmes, continue de transmettre ces valeurs (Gadrat et Favreau à Louis-le-Grand; Maublanc et François à Henri IV; Angrand à Carnot ; Decourdemanche à Rollin; Husson à Pasteur; Lablénie à Janson-de-Sailly; Charmoillaux à Versailles). Des intellectuels communistes (Danielle Casanova, Georges Politzer, Jacques Solomon, Pierre Villon) impulsent la naissance du journal clandestin l'Université Libre, tandis que l'union des étudiants et des lycées communistes (U.E.L.C.) reconstituée diffuse, sous le manteau, La Relève. D'autres groupes se forment comme Maintenir autour de l'étudiant Claude Bellanger. Certaines organisations étudiantes restées légales ou tolérées (corporation de Lettres ou de Droit, Union Nationale des Étudiants) deviennent des foyers de rencontre pour tous ceux qui participent de cette mobilisation sourde. Deux événements concomitants vont libérer brusquement cette énergie potentielle: l'arrestation du professeur Langevin et l'interdiction des célébrations traditionnelles de la fête nationale du 11 Novembre.
L'annonce de l'arrestation par la Gestapo, le 30 octobre, du professeur Langevin (professeur au Collège de France, physicien mondialement connu, figure du Front Populaire) entraîne une riposte publique immédiate. Un comité de soutien large se constitue. Un tract clandestin de l'U.E.L.C. appelle à une manifestation le 8 novembre. Un autre, tiré sur la ronéo du centre d'entraide (Claude Bellanger), rédigé par François Lescure (président de l'U.N.E.) et Roger Marais (Corporation Lettres) lance le même appel, complété par un autre à manifester le 11 novembre à l'université et dans les grandes écoles. Dans le même temps, les médias aux ordres martèlent l'interdiction faite par l'occupant et par Vichy de célébrer la fête nationale marquant la victoire sur l'Allemagne en 1918. La manifestation pour la libération de Langevin a lieu dans un quartier Latin. En état de siège. Fort de ce résultat, le soir même, lors d'une réunion du groupe Maintenir, à laquelle ils ont été invités, François Lescure et Roger Marais rédigent le tract d'appel à la manifestation du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, texte qu'ils ronéotypent, à nouveau, au centre d'entraide. Dès le lendemain, il est largement diffusé dans les établissements secondaires et supérieurs de la capitale.
Dans le même temps, le 10 au soir, sur les ondes de la B.B.C., Maurice Schumann, porte-parole de la France Libre, conclut son message par un appel pour le 11 novembre à tous les français à "sur les tombes de vos martyrs, renouvelez le serment de vivre et de mourir pour la France". Cette même volonté de manifester ce 11 novembre est aussi présente chez de nombreux étudiants et surtout lycéens le plus souvent de tradition nationaliste. Tract, appel de la B.B.C., bouche à oreille, concourent à une mobilisation qui voit ainsi converger pour la première fois des individus et des groupes venus d'horizons divers. Par petits groupes, en chantant la Marseillaise, en criant Vive de Gaulle, ou en lançant des slogans hostiles à l'occupant et à Pétain, ce sont des milliers de jeunes qui montent à l'Étoile le soir du 11 novembre 1940. Appuyant la police française, les troupes nazies chargent. La répression est violente. Le nombre des blessés est inconnu. On dénombre plus de cent arrestations. L'Université est fermée, le recteur Roussy est révoqué. Les responsables des organisations étudiantes sont convoqués par le directeur de l'Institut Allemand qui, menaçant, leur reproche de compromettre l'œuvre de collaboration de Pétain.
Le 11 novembre au matin, sur les Champs-Elysées, les membres du groupe du Musée de l'Homme fleurissent la statue de Georges Clémenceau. Toute la journée, des grèves importantes paralysent les bassins miniers du Nord et du Pas-de-Calais. A Rouen, à Dijon, à Nantes, des gestes de jeunes font aussi événement. Enfin, coïncidence symbolique, Vichy révoque ce jour le préfet républicain Jean Moulin.
La résistance
La manifestation du 11 novembre, à Paris, surgie de l'université parisienne est la première grande action à résonance nationale de la Résistance française. De ce jour, pour un grand nombre de français, la collaboration apparaît pour ce qu'elle est : synonyme de répression et de complicité avec l'occupant. C'est un signal pour engager d'autres combats.
Le nombre des Résistants français
Voilà encore une estimation qui conduit régulièrement à des débats et discussions vives. Les chiffres avancés varient de 300 000 à 500 000 résistants pour l’année 1944.
Robet O. Paxton donne le chiffre de 300 000 cartes de combattants délivrées : 130 000 à des Déportés, 170 000 à des Combattants Volontaires de la Résistance. Il ajoute les 100 000 qui sont morts au combat pour approcher le total des résistants actifs ou reconnus comme tels, ce qui donne environ 2% de la population française. Il faudrait cependant prendre en compte les 10% de sympathisants qui lisaient les journaux clandestins et acceptaient de prendre un risque léger. C’est ce que fait Jean Pierre Azéma en chiffrant Résistants (230 000 cartes) et sympathisants actifs à un ordre d’environ un million.
Officiellement, le Secrétariat d’Etat aux Anciens combattants et Victimes de guerre prend en compte, pour le calcul des droits à la retraite, les services accomplis dans la Résistance après l’âge de seize ans. Les services rendus dans la Résistance doivent avoir duré au moins trois mois avant le 6 juin 1944 et avoir été homologués ou prouvés par deux témoignages circonstanciés établissant sur l’honneur la réalité ainsi que la durée de l’activité accomplie émanant de personnes notoirement connues dans la Résistance.
Selon une discussion au Sénat, un peu plus de 260 000 cartes de Combattant Volontaire de la Résistance ont été délivrées jusqu’en 1996. Le chiffre est proche de celui des 230 000 cartes retenu couramment et tient certainement compte des cartes distribuées tardivement.
Toutefois, il est important de rappeler que tous les résistants n’ont pas sollicité la reconnaissance nationale, beaucoup sont morts ( déportés, fusillés ou morts au combat), certains n’ont pas pu faire "homologuer" leurs actions.
Les Médaillés de la Résistance
A Londres, par ordonnance n° 42 et par décret n° 774 du 9 février 1943, le Général de Gaulle institue la Médaille de la Résistance Française, destinée à reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l’Empire et à l’étranger, auront contribué à la Résistance du peuple français contre l’ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940 .
L’ordonnance du 7 janvier 1944 précise qu’il s’agit des personnes ou collectivités françaises qui ont :
1. pris une part spécialement active depuis le 18 juin 1940 à la Résistance contre les puissances de l’Axe et leurs complices sur le sol français ou en territoire relevant de la souveraineté française,
2. pris une part effective importante au ralliement de territoires français ou rendu des services signalés dans l’effort de guerre de ces territoires,
3. joué un rôle éminent à l’étranger dans la propagande et dans l’action des organisations destinées à grouper et à soutenir les efforts de la Résistance,
4. rallié les troupes, les navires ou les avions dans des conditions exceptionnelles de difficultés ou de dangers,
5. rejoint les Forces Françaises en guerre dans des conditions particulièrement dangereuses et méritantes. Cette ordonnance a été complétée par l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui a créé la Médaille de la Résistance avec rosette dont les titulaires recevaient le titre d’Officier de la Résistance (4.345, soit environ 10 % du chiffre total d’attribution).
Les Médaillés de la Résistance Française, au nombre de 43.000 environ, dont 19.000 à titre posthume, groupent les plus méritants des membres des Forces Françaises Libres, des Forces Françaises Combattantes et des Forces Françaises de l’Intérieur. Parmi eux, 10 % de femmes et 55 collectivités.
Enfin, de 1941 à 1946, date de la fin de l’attribution de la Croix, 1.059 Croix de la Libération ont été attribuées. Le nombre limité de Compagnons ne fait alors que souligner leur valeur exemplaire.
L’aide aux personnes persécutées et pourchassées en France
Elise Rivet,Mère Marie Elisabeth de l’Eucharistie, Juste parmi les nations
15 août 1944 - Duerne - Un parachutage tragique. Pour compléter, on lira avec profit le livre de Joseph Besson - Bertrand, Chronique des années sombres, 1940-1944. Secteur de St-Symphorien-sur-Coise, Imprimerie des Monts du Lyonnais. Saint-Martin-en-haut. 1983 ou dans Les Chapeliers de Rodolphe, Clément Fereyre, Lyon 1988, les souvenirs des Anciens du G.M.O. Liberté qui se rattachent à cet accident et à ce sauvetage.
Entre 1934 et 1945, plusieurs familles juives ont été hébergées à Mornant. Le 13 mai 2007, en souvenir et en remerciement, les personnes recueillies ont tenu à offrir une plaque commémorative à la commune. Contacter la Mairie de Mornant. A partir de la biographie du commandant Mary-Basset, on peut approfondir son action dès 1940 dans les réseaux de Chalon-sur-Saône, comme le réseau Brandy : Dès 1940, dans la région de Chalon-sur-Saône, il a rejoint l’un des premiers réseaux de Résistance. De nombreux prisonniers évadés, agents de la France Libre, pilotes alliés ont franchi grâce à lui la ligne de démarcation. Arrêté par la Gestapo en 1942.
André Romanet, Le temps de la Comète - Souvenirs et réflexions d’un instituteur engagé, Instituteur à Salles en Beaujolais avant et pendant la guerre, André Romanet a recueilli et caché des enfants juifs et de résistants et, dès l’automne 44, a organisé (avec Y.FARGE) l’accueil et l’hébergement dans plusieurs villages d’enfants, dont principalement MEGEVE, des enfants orphelins, déplacés, en mauvaise santé. Il a été nommé Juste parmi les nations.
Le Chambon sur Lignon, terre d’accueil et de sauvetage pour un grand nombre de victimes de la guerre, est le symbole de l’opposition des protestants vis-à-vis du nazisme et de l’antisémitisme. est difficile à ignorer. De nombreux sites évoquent le souvenir des Justes du Chambon comme celui du Musée protestant de la Fondation Chambon ou Dominique Natanson.
Georges Loinger, passeurs d’enfants. Originaire de Strasbourg, Georges Loinger a contribué à sauver de nombreux enfants vers la Suisse, avec le maire d’Annemasse, Jean Deffaugt, et l’aide de cheminots.